05:00
Où va la Mauritanie ?
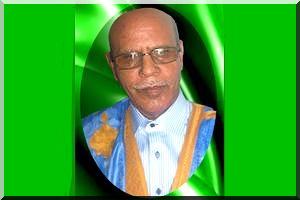
Suite au débat soulevé par le livre de M. Isselmou Abdel Kader, intitulé "Où va la Mauritanie ?", édité par les Editions Panafrika, Silex/Nouvelles du Sud, nous avons décidé, avec la permission de l’auteur que nous remercions vivement, de publier cet ouvrage au fur et à mesure de nos livraisons hebdomadaires.
L’auteur lui-même ne prétend pas d’être un historien, anthropologue ou sociologue, mais par un administrateur civil ayant, pendant plus de trente ans, travaillé sous différents régimes et à de nombreux postes de l’Administration mauritanienne.
Son parcours lui a permis de lire des rapports enrichissants d’administrateurs coloniaux et d’autres encore plus récents. Il a commandé plus de la moitié des régions du pays en qualité de préfet ou de gouverneur, occupé des postes sensibles au Ministères de l’Intérieur, collaboré techniquement avec la plupart des officiers qui ont eu à diriger ce Département.
Il a approché la plupart des courants idéologiques du pays et fut témoin de ceux parmi les événements qui ont le plus marqué l’histoire de la Mauritanie depuis 1979. Il ne s’agit pas ici de mémoires, mais d’une lecture des faits sans en donner les détails pouvant incriminer, rouvrir les plaies ou raviver le sentiment de haine en un moment où les Mauritaniens ont besoin de s’unir et de se surpasser, pour survivre au souvenir amer de leur histoire récente.
L’auteur demande au lecteur de comprendre la prudence avec laquelle certains faits sont relatés et le caractère scientifiquement hybride de cette modeste contribution. Il s’attend à ce que ses concitoyens soient choqués par l’image négative que véhicule cet ouvrage à propos d’eux. C’est justement pour cette raison qu’il l’a écrit, car pense-t-il, les Mauritaniens ont besoin d’être secoués, pour se ressaisir à temps et faire un effort leur évitant de sombrer à nouveau dans la barbarie des derniers siècles.
Introduction
La Mauritanie est indépendante depuis 1960; elle est à un âge auquel il n’est plus permis de pardonner aux États certaines insuffisances, car ils doivent avoir appris à exister, à se conduire comme des entités fondées sur un minimum de règles de justice et de décence.
La première génération de ses dirigeants donna un exemple de courage, de patience et de sagesse qui permit de jeter les fondements d’un Etat-Nation.
La deuxième a failli faire sombrer le pays dans le chaos en risquant à chaque fois, de réveiller les démons des guerres tribales et de créer de nouveaux genres de conflit – racial notamment- qui n’avaient jamais existé auparavant.
La troisième, celle qui a en main le destin du pays, est appelée à avoir la sagesse nécessaire pour obvier au danger de dislocation du pays en faisant revenir les démons d’un passé lointain. Elle doit se mettre au dessus des clivages déchirants et surmonter les difficultés inhérentes à la gestion de la diversité du pays.
Elle doit, en un mot, avoir le courage et la lucidité pour écarter les dangers intérieurs et extérieurs qui apparaissent pour la première fois. Pour y arriver, il semblerait nécessaire, au risque de heurter bien des sensibilités, d’étudier l’expérience bonne ou mauvaise des régimes antérieurs, afin d’en connaître les insuffisances et d’en éviter les erreurs.
Comme tous les autres peuples, les Mauritaniens ont combattu la pénétration coloniale, défendu son leur territoire et survécu pour pouvoir, plus tard, créer leur Etat. Ils réussirent, grâce au courage d’un petit groupe d’hommes et de femmes, à avoir une colonie distincte, puis un État formellement indépendant malgré les difficultés de tous genres.
La quête de l’identité culturelle fut d’abord le principal mobile du nouvel État d’emblée confronté au tumulte d’un débat auquel il n’était guère préparé, mais qu’il put mener, malgré sa diversité, dans une parfaite sérénité. Ce fut une période de fermentation des idéologies nationalistes qui avaient jusqu’alors l’ambition de transcender le tribalisme, principal obstacle à la formation d’une nation.
Mais ce nationalisme fut mal canalisé, mal exprimé, faute de cadre approprié et de place pour tous sous le nouveau toit national. Il dut constituer plus tard, sous toutes ses facettes, une source de danger permanent pour la cohabitation fraternelle des différentes ethnies du pays.
Cependant, ce ne fut la difficulté de gérer la diversité qui constitua la principale menace pour la survie de cet État-miracle, mais l’ambition démesurée de ce dernier qui le conduisit à entreprendre une guerre à laquelle rien ne le disposait. D’ailleurs, après avoir été incapables de mener cette guerre, nos vaillants soldats finirent par choisir de renverser le régime en augurant période d’aventure qui faillit, plusieurs fois, faire sombrer le pays dans la guerre civile.
Après trente ans de cauchemar durant lesquels les mauritaniens ont vécu toute forme de tentative de camouflage des bottes sous un habillage civil, l’aristocratie militaire décida, le 3 août 2005, à l’issue d’un putsch qu’on espérait être le dernier, de mettre en place des institutions réellement démocratiques. Le pays faisait alors face à de nombreux défis résultant à la fois du passif du régime militaire lui-même et d’une accumulation de déséquilibres, d’inégalités criantes et de cicatrices sans nom.
Cet héritage peu glorieux des régimes militaires successifs pesait et pèse encore lourdement sur l’avenir du pays qui, en 2007, arriva à élire pour la première dans une transparence incontestée, un gouvernement dont elle attendait tout et de manière urgente. Pouvait-t-il répondre à cette attente ou n’allait-t-il même pas avoir le temps de se mettre sur les rails?
La mission dévolue au gouvernement issu de telles élections étaient difficiles, voire impossible, car elle consistait, après restitution à la société de ses valeurs positives d’antan, à réformer l’État en assainissant son administration et en mettant toutes ses institutions à égale distance de tous les citoyens sans distinction.
Il fallait en d’autres termes supprimer toutes les formes de rente du Pouvoir qui auraient provoqué ou encouragé l’émergence de nouvelles formes d’inégalités. Il devait ensuite niveler celles de toute sorte, ayant résulté de cette rente ou de celle de l’Histoire et traiter adroitement des plaies causées par des événements douloureux comme ceux des années 1990 ou par la guerre entre clans militaires.
Les historiens, les sociologues et les anthropologues trouveront certes, des choses à redire à l’endroit de cette modeste relecture de l’histoire politique récente de la Mauritanie. On comprendra bien leur rigueur scientifique tout en comptant sur leur indulgence, d’autant plus qu’il ne s’agit pas d’une œuvre de recherche académique. C’est, tout au plus, un travail d’amateur étonné et désolé de voir ses compatriotes ayant plus de science à diffuser, renoncer à écrire l’histoire de leu pays, par peur d‘être rejetés par une société dont les morts continuent de traquer et de terroriser les vivants.
L’essentiel avait été de puiser, pour ne pas dire voler, dans chacune de ces disciplines, les éléments pouvant aider à comprendre l’évolution de la société mauritanienne pendant près d’un siècle. Cette réflexion vise principalement, même sans plus de recherches et d’argumentation, à souligner des vérités qui échappent ou semblent échapper à beaucoup de mauritaniens.
Les Berbères Sanhadja, et encore moins les tribus de souche arabe ou Béni Hassan, n’avaient pas été les seuls acteurs de l’islamisation des peuples de la région ouest africaine. Certaines tribus béni Hassan avaient été combattues par les Emirs du Fouta ou Almamy qui leur reprochaient leur hétérodoxie.
Certaines tribus arabes sont devenues négro-africaines par le fait d’une lente et méticuleuse assimilation culturelle, alors que d’autres ont engendré de nombreux porte-drapeaux du nationalisme arabe bien qu’elles soient incontestablement d’origine négro-africaine. Chacun est devenu l’autre en l’oubliant, en l’ignorant et en combattant ses propres gènes.
Le fondement du concept de nationalité et de la stratégie politique fondée sur le facteur linguistique ne serait qu’un leurre, car dans le fond, la langue arabe est autant celle de l’ethnie halpular que celle des maures, surtout quand ils sont Sanhadja. Le dialecte pular contient, sinon plus, en tout cas autant de mots d’origine arabe que celui parlé jusqu’à présent par les tribus berbères de Mauritanie.
Il en résulte que, dans le contexte mauritanien, les rivalités entre courants soi-disant nationalistes se fondant sur un concept ethnocentriste de nation, ne pourrait déboucher que sur un racisme vulgaire.
Enfin, les Mauritaniens continuent d’utiliser des concepts sans contenu comme celui de haratine qui, avec l’évolution du pays et la différenciation socio-économique qui en résulte, a perdu tout contenu concret. Il n’y a plus en effet de statut social haratine depuis la réforme foncière et l’accès des paysans à la pleine propriété terrienne.
Peut-être, existe-t-il encore dans certaines régions comme celles de l’Aftout, de l’Affolé et des Hodhs, des vestiges de l’ancien régime foncier de type féodal qui est juridiquement aboli. Mais d’une manière générale, le statut de haratine tel qu’il résulte d’un rapport de production fondé sur une forme d’appropriation du sol, est définitivement révolu.
On continue, cependant, à étendre un tel statut à des personnes aussi différentes de revenus, de rang social et de niveau culturel que les simples paysans de l’Affolé, les chevillards des abattoirs de Nouakchott et des catégories sociales représentées par d’éminentes personnalités comme MM. Messaoud Ould Boulkheir président de l’Assemblée Nationale, Sghair Ould Mbarek ancien Premier Ministre et Mohamed Said Ould Hamoddy, écrivain, ancien ambassadeur et chef traditionnel.
Il s’agit, dans cet ouvrage, d’aborder ces questions dans le souci de montrer à quel point, les problèmes de la Mauritanie sont faciles à résoudre, pourvu qu’ils soient traités sans tabou. C’est donc une simple contribution à ce débat qui essaie autant que possible et sans vouloir glorifier ou offusquer qui que ce soit, de donner une modeste opinion à propos de certains sujets réputés sensibles et de quelques événements de l’histoire récente d’un pays où les faits sont souvent interprétés selon le désir de celui à qui ils sont rapportés.
En tout état de cause, il semble urgent que les Mauritaniens acceptent sans complexe, de bien se fixer du regard et d’avoir le courage de résister à leur réflexe de nomades, toujours prompts à fuir vers de nouveaux espaces, quand ils ne peuvent ou ne veulent plus regarder celui qu’ils occupent.
A suivre sur Mauritanoix chaque semaine