08:05
Le problème des sources d'histoire et des historiens locaux
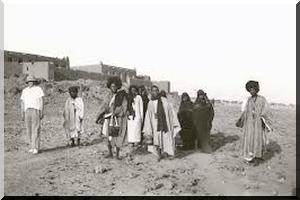
Adar-Info - Dans son ouvrage remarquable Comment on écrit l’histoire ?, Paul Veyne (1971) a noté que, pour faire de « l’histoire vraie », c’est‐a‐dire de l’histoire historienne occidentale, il faut deux choses : d’abord que les évènements aient eu lieu et ensuite qu’ils aient laissé des traces, des documents. Cette proposition a plusieurs implications conceptuelles.
Disons d’abord que la branche académique que nous appelons « Histoire » ne va pas de soi, elle appartient à la civilisation occidentale ou européenne. Cela ne veut pas dire que les « évènements » n’ont lieu que dans cette civilisation, mais que c’est seulement au sein de celle‐ci que s’est développée l’idée que les évènements sont : (1) vrais et (2) laissent des traces.
Dans ces conditions, on peut conclure que le sens accordé au concept d’histoire n’est pas le même partout. Ainsi, dans les sociétés non‐occidentales comme les sociétés sahariennes et sahéliennes, les évènements peuvent être conçus comme vrais, même en l’absence de traces matérielles qui les confirment.
Mieux, ces traces, que nous appelons des sources d’histoire, peuvent être rares, voire inexistantes, ou coexister avec des légendes ou des mythes parfois écrits ou conservés par la « tradition orale ». Dans tous les cas, cette absence documentaire pose un problème important pour la reconstruction de leur Histoire, au sens occidental du terme.
On peut dire, en effet, que les diverses sociétés actuelles de Mauritanie ne se sont pas intéressées à l’écriture d’une histoire de leur passé depuis les « origines » jusqu’au présent. Cet intérêt est né seulement avec la présence coloniale et ne s’est vraiment développé qu’après l’indépendance, situation répandue dans les anciennes colonies d’Afrique ou d’ailleurs.
De fait, l’accession au rang d’État moderne conduit à la construction nécessaire d’une nation ayant une Histoire commune, d’où pourra émerger, plus tard, un nationalisme unificateur (Hobsbawm 1990, 1992). Dans l’état actuel de la recherche, les sources écrites du passé en Mauritanie se limitent à quelques chroniques ultérieures au XVIIe siècle, alors que des ouvrages importants ont été rédigés sur les thèmes canoniques des civilisations musulmanes (traités de grammaire arabe, de théologie, de mathématiques…).
Les traditions orales, en tant que constructions historiques du passé, sont les seules « sources » d’histoire politique, qui sont bien plus importantes et mieux organisées dans les sociétés africaines wolof, halpulaar’en et mandé que chez les Bidân. La raison de cet état de choses est probablement associée aux différences de systèmes politiques. Les sociétés africaines voisines avaient en effet des systèmes centralisés et dynastiques dans lesquels le souvenir et la mémoire des faits politiques et des légitimations généalogiques étaient importants pour la reproduction du système social et politique.
Il en allait autrement dans les sociétés sahariennes non centralisées, comme la société bidân, dont les événements politiques étaient restreints, aussi bien géographiquement que dans le cadre étroit des groupes et des familles de chefferie. Cette différence dans le traitement attribué aux traditions du passé est visible lorsqu’on observe que dans les sociétés africaines centralisées, comme chez les Wolof, les Halpular’en et les Mandé, les bardes et les « traditionnistes » (spécialistes de la tradition) sont nombreux et que leurs histoires légendaires se transmettent suivant une organisation complexe et systématisée.
Chez les Bidân, les bardes et les chroniqueurs étaient peu nombreux et leurs chroniques locales étaient sujettes à des remaniements fréquents en fonction des objectifs politiques du moment. La seule exception à cette proposition générale est constituée par le mouvement almoravide du XIe siècle, qui fait figure de mythe de fondation, d’arabisation et d’islamisation, pour l’ensemble de la société bidân (P. F. de Moraes Farias 1967, Norris 1972, Stewart 1973).
Sans entrer dans les détails ardus de cette problématique, on peut avancer quelques hypothèses sur l’héritage conceptuel de certains érudits traditionnels qui reflètent une manière particulière de concevoir le passé de leur société.
L’héritage des érudits traditionnels : une production d’histoire locale
Les diverses sociétés de la Mauritanie actuelle possédaient des spécialistes qui connaissaient l’écriture arabe, il ne s’agissait donc pas de sociétés sans écriture, classées formellement comme « primitives » mais qui, en dehors de cela, voient « la réalité exactement comme nous », avec « des philosophies par lesquelles [ils] essaient de décrire ou de justifier cette réalité » (Veyne 1971 : 101).
Parmi ces philosophies, les archétypes et les mythes d’origine occupent une place importante. Cela étant posé, la distinction de Veyne entre « primitifs » et « civilisés » en fonction de l’écriture n’est pas satisfaisante pour notre propos. En effet, les sociétés saharo‐sahéliennes semblent avoir disposé de deux paradigmes dans la manière de penser leur devenir.
D’une part, les idées archétypales et les mythes d’origine, impliquant que le temps est cyclique et que leur existence ne faisait que se répéter en suivant un modèle immuable, une norme mythique ou ancestrale. Et d’autre part, les idées historiennes qui considèrent que le temps est linéaire, qu’il y a des causes et des effets, avec des ruptures et des événements qui marquent un avant et un après.
Ainsi, si l’on pouvait penser que le monde était habité par des esprits, des génies, des diables et des anges, ou que les miracles étaient le lot commun des saints hommes, ces croyances n’ont pas empêché certaines personnes savantes d’écrire des textes dans lesquels ils ont répertorié des événements qui marquaient des ruptures temporelles : les disettes, les famines, les guerres, les batailles, les morts des grands personnages guerriers ou lettrés, les éclipses…
Les idées mythiques coexistaient, et coexistent aujourd’hui même, « le plus pacifiquement du monde » (Veyne 1971 : 101) avec les idées sur le devenir historique. Posons que les histoires locales, couchées dans des chroniques, sont toutes issues des traditions orales qui ont circulé pendant longtemps, se construisant et se reconstruisant, avant qu’on ne les ait consignées par écrit, les fixant ainsi « pour l’éternité ».
Plusieurs de ces chroniques locales ont été rédigées en dehors de toute influence extérieure, européenne ; elles doivent donc être distinguées des chroniques écrites pendant ou après la colonisation et qui ont reçu, forcément, des inflexions historiques et politiques importantes. Parmi les auteurs les plus anciens et les plus ouvertement historiques de la société bidân, on citera al‐Yadâli (de la région de la gebla) et Muhammad Sâlih (de la région du Hawd).
Mariella Villasante Cervello : »Les producteurs de l’histoire mauritanienne, malheurs de l’influence coloniale dans la reconstruction du passe des sociétés sahélo sahariennes »