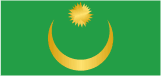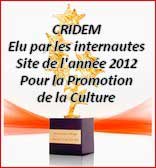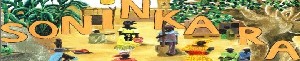24-09-2010 12:40 - Energie solaire et développement en Afrique : le saut quantique ?

Les perspectives technologiques et économiques de l'énergie solaire sont à court terme susceptibles de faire faire un saut quantique dans l'accès à l'énergie de la partie de l'humanité qui en est le plus privée, l'Afrique, l'exonérant d'attendre un hypothétique raccordement au réseau fixe, mais également fournissant une énergie plus durable que celles utilisées aujourd'hui, estiment Denis Florin associé en charge de l'énergie et Jean-Michel Huet, responsable des pays émergents chez BearingPoint.
L'un des derniers modèles de « smartphone », le Puma, lancé au cours de l'été, présente la particularité d'avoir une coque supérieure constituée de cellules photovoltaïques permettant au téléphone de se recharger au soleil et donc d'éviter les risques de batteries plates. Malgré son prix encore élevé ce téléphone connait un engouement dans les pays Africains.
L'énergie reste dans les pays émergents une ressource rare qui freine leur croissance. Pourtant, les progrès de la technologie des panneaux solaires annonce une révolution énergéticienne, tant par l'apport solaire que le modèle économique et l'organisation qui la sous-tend.
Prenons le cas du village mauritanien de Mata Moulana. Il n'existe que par ce que des géologues ont trouvé de l'eau à 80 mètres sous terre. A quatre heures de pistes de Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, iI ne sera probablement jamais relié au réseau électrique mauritanien. La principale source d'énergie, ce sont les ânes, attelés à quatre à leur noria, aidés parfois d'éoliennes.
Ces sources limitées et aléatoires brident le développement du village. Tout porte à croire que la situation restera précaire, même si l'introduction du téléphone portable a un peu brisé l'isolement. Cette situation se répète constamment dans les villages des pays émergents.
Pourtant une rupture est intervenue. Graduellement, des ONG commencent à introduire des panneaux solaires qui, une fois installés, durent prés de 25 ans avec un entretien minimal. Ces panneaux permettent de mécaniser l'accès à l'eau, mais aussi de faire fonctionner le relais du téléphone cellulaire. Leur apport énergétique faible, mais constant, à la différence des éoliennes, et indépendant du réseau national, change graduellement les perspectives des habitants.
L'accès au monde extérieur, que ce soit par Internet, la télévision ou le téléphone devient permanent, bien que limité, et non plus tributaire des voyageurs de passage. Dans une perspective proche, il devient envisageable de substituer aux groupes électrogènes, fonctionnant avec un pétrole de plus en plus cher, des moteurs électriques (idéalement couplés avec une batterie tampon). Au-delà, un accès fiable à des sources, même faibles, d'énergie électrique permet d'espérer la fin des corvées de bois, source de temps perdu, de risques personnels et de déforestation.
Cependant, ces panneaux restent trop chers pour les seuls villageois, qui dépendent toujours de l'aide internationale pour leur achat. Fondé sur une technologie classique (polysicium), ils ont des rendements limités, 15 à 20 % seulement de l'énergie reçue devenant de l'électricité. Cette situation va probablement s'améliorer rapidement.
Selon une étude de la Deutsche Bank, à mesure que l'industrie des panneaux solaires vit sa classique courbe d'expérience industrielle, les coûts en baisse permettent d'envisager un équilibre entre le coût de l'énergie solaire et celui d'un réseau électrique traditionnel occidental type à l'horizon 2015.
La diffusion de ces sources de petite ressource électrique décentralisée dans la plupart des pays émergents d'ici la prochaine décennie peut donc être anticipée et accélérée grâce à l'arrivée de nouvelles technologies comme le silicium amorphe ou les « thinfilms ».
Cette diffusion se fera selon le précédent connu de l'industrie téléphonique. En 2009, sur 400.000 villages africains, 45 % bénéficient d'une couverture mobile contre 3 % pour des lignes fixes. Celles-ci coûtent cher à déployer, le cuivre, qui compose les lignes, est souvent volé car sa valeur marchande est significative.
A contrario en 10 ans, la téléphonie mobile a pris une ampleur sans précédent et aujourd'hui plus du tiers des africains ont un mobile. La plus grande facilité de déploiement du réseau, le modèle de carte à gratter (pas d'abonnement), la possibilité de mutualiser les appels (les « village phones ») expliquent ce succès. L'importance de la téléphonie mobile est telle que l'Internet se développe plus via mobile que ligne fixe en Afrique.
L'arrivée du téléphone portable a permis une déclinaison des modèles de micro-finance et de micro-entrepreneuriat. De nombreux pays émergents ont ainsi vécu en quelques années un « saut quantique » en matière de télécommunication, fondé sur une architecture technique décentralisée qui s'affranchit largement d'infrastructures fixes continues.
L'industrie solaire s'apprête à faire franchir le même saut quantique à l'énergie, en ajoutant à l'architecture décentralisée une composante critique. En effet, à la différence de la technologie téléphonique cellulaire, qui doit s'appuyer sur des organisations centrales ou au moins régionales pour installer et entretenir les relais, les panneaux solaires une fois installés n'ont pas besoin d'une grande société pour les entretenir.
Un entrepreneur en travaux publics, voire un particulier débrouillard, peut aisément en être à la fois le revendeur et l'installateur. Il est donc légitime de prédire que, à la différence des pays développés, les grands énergéticiens des pays émergents se concentreront sur des réseaux fixes limités (capitale et grandes villes) pour assurer l'alimentation électrique des gros consommateurs (industries, hôpitaux, administrations, aéroports).
Ce modèle « dual » est une excellente nouvelle énergétique pour la planète, même s'il n?est pas parfait (la fabrication de cellules solaires consomme de l'énergie et peut être polluante, de même que celle de batteries). Ainsi que nous l'a rappelé Al Gore, le modèle énergétique occidental, d'ailleurs peu durable, ne peut être appliqué aux pays émergents : pour surmonter la raréfaction des énergies fossiles et la déforestation, le complément solaire décentralisé représente une alternative technologiquement et économiquement crédible.
Ce progrès a un effet d'entraînement, puisqu'il devrait permettre de renforcer le développement de la téléphonie mobile dont l'un des freins actuels est la difficulté, dans certaines zones, de recharger la batterie des téléphones. Si aujourd'hui les chargeurs de type dynamo ont un certain succès, les chargeurs solaires pour téléphone (encore 80 % plus chers que les dynamos) devraient être à un prix compétitif d'ici 1 ou 2 ans.