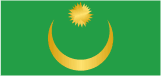19-09-2012 07:15 - Interview avec Sophie Caratini, Outil de recherches sur la Mauritanie : « Je veux transmettre à la jeune...

Directrice de recherche au CNRS, membre de l’Équipe Monde Arabe et Méditerranée, Sophie Caratini est une anthropologue spécialiste de la Mauritanie et du Sahara Occidental. En décembre dernier, elle était à Nouakchott et Rosso dans lors des rencontres littéraires de l’Association Traversées Mauritanides. A peine neuf mois après, elle est de retour.
Cette fois pour un projet qui lui tient à cœur : une bibliothèque digitale, avec de multiples entrées linguistiques, sur la Mauritanie. Autant dire un outil de haute importance, pour les chercheurs mais aussi pour toute personne qui voudra s’informer sur la Mauritanie.
Dans la continuité de ses recherches, nous avons saisi l’opportunité de ce énième séjour, pour demander à « Sophie », tout le monde appelle ainsi cette dame qui connaît ce vaste pays, du village le plus reculé du Fouta aux fouilles d’Aghrejitt en terres voisines des sites Nmadis, de nous en dire un plus sur ses rapports à la Mauritanie, ses hommes, ses femmes. Son dernier cadeau à la Mauritanie, après Les enfants des nuages (Ed. du Seuil, 1993), s’appelle La Fille du chasseur (Ed. Thierry Marchaisse, 2011).
Le personnage, une femme Maure, a vécu dans les sillages d’un destin singulier. Aucun regret cependant, que de l’épanouissement. Le visage lumineux, sur la couverture du livre, en témoigne. Et cet être sensible, plein d’énergie, et qui offre son récit romanesque s’appelle Mariem. Vivant aujourd’hui à Paris, en France, son récit débute à l’époque où la Mauritanie était encore française, vers 1940. Quand les chasseurs N’madi, communauté dont elle est issue, nomadisaient dans leur espace. Les années ont passé, mais la mémoire est là, alerte et vivace malgré ses 71 ans ! La Fille du chasseur, un livre à lire, tellement le style servi avec ferveur et de saveur.
Qui est Mariem, et comment est née l’idée de lui consacrer un roman ?
Mariem Mint Touileb est Mauritanienne. Ahmed Baba Miské, qui était mon tuteur de mémoire de maîtrise en 1973, m’avait donné ses coordonnées, disant que je pourrais rencontrer chez elle des Mauritaniens. Je cherchais à l’époque à rencontrer des Rgaybat, car j’avais un projet suggéré par mon tuteur de mémoire sur l’économie pastorale des grands chameliers.
Nous sommes devenues amies, puis la vie nous a un peu éloignées. Je l’ai retrouvée un jour, par pur hasard au milieu d’une foule immense descendue dans les rues de Paris pour manifester contre l’engagement de la France dans la première guerre du Golfe. C’est là, au milieu du cortège qui nous avait réunies, que nous sommes tombées dans les bras l’une de l’autre. Au bout de quelques échanges, elle m’a demandé d’écrire l’histoire de sa vie. J’ai simplement dit « oui ». Et comme vous avez pu le comprendre, il ne s’agit pas d’un roman.
On sent une forte influence anthropologique, dans la construction de son récit. Avez-vous hésité sur le genre à adopter pour restituer sa vie ?
Cela va s’en dire, puisque je suis anthropologue. Lorsque Mariem m’a fait cette demande d’écrire sa vie, j’étais en pleine interrogation sur les relations franco-arabes, non seulement à cause de la guerre du Golfe, mais parce que le département d’Ethnologie de l’Institut du Monde Arabe que je dirigeais venait d’être supprimé. L’anthropologie dérange, vous savez ! J’avais donc décidé de réorienter mes interrogations non plus sur l’Autre mauritanien, mais sur la relation que l’un entretient avec l’Autre, en l’occurrence la relation franco-mauritanienne, telle qu’elle s’était construite dans l’extrême Nord de la Mauritanie, puisque c’était là que j’avais effectué mes premières recherches.
J’enquêtais donc sur les groupes nomades, forme essentielle de la présence française dans ces régions, en particulier auprès du général Jean du Boucher qui avait été jeune officier au GN d’Idjil entre 1933 et 1935. J’ai eu l’immense surprise, lors des premiers entretiens avec Mariem, de découvrir qu’elle avait grandi elle aussi dans un GN, en l’occurrence dans celui d’Atar dans les années 1940-1950. C’est là que j’ai commencé une double enquête en miroir, allant enregistrer successivement chaque semaine Mariem et Jean. Puis mon idée première évoluera vers le projet d’une trilogie sur la rencontre coloniale. Autrement dit publier trois récits témoignant chacun d’une part du vécu, et surtout du point de vue des représentants de chacune des trois cultures que ce moment de notre histoire commune a mises en présence.
Toujours en vie, comment Mariem a reçu son histoire narrée ?
Mariem, Dieu merci, est en fort bonne santé. Elle n’a pas reçu un beau matin toute son histoire narrée, puisqu’elle a suivi toutes les étapes du travail de mise en perspective de ses propos d’abord, puis de leur transcription littéraire ensuite. La fille du Chasseur est le résultat d’un travail, qui s’est étalé sur 20 ans, et qui a commencé par deux années d’entretiens hebdomadaires. Des moments enrichis par l’approfondissement de notre amitié.
Ensuite, il a fallu décrypter plus de cent cinquante heures d’entretiens enregistrés, mettre les éléments en ordre, identifier les manques ou les contradictions, reprendre les entretiens, recommencer etc. Puis l’écriture elle-même s’est faite sur plusieurs années, bien sûr avec des interruptions là aussi. Ce fut un lent façonnement, partant de la retranscription de la parole dite pour la transposer en écriture littéraire, tout en procédant à des réajustements, des modelages etc. C’est difficile à expliquer, mais c’est le travail de toute retranscription ! A la fin, Mariem considérait que si le texte écrit était issu de sa parole, il était clair que j’en étais l’auteur. « Ce sera ton bébé maintenant », disait-elle. A l’arrivée, lorsque mon éditeur lui a demandé ce qu’elle en pensait elle a répondu : « je n’en retirerais pas une ligne ».
Allez-vous poursuivre sur d’autres récits de ce genre ?
Comme j’ai eu à le dire, plus haut, je suis dans la lancée d’une trilogie. Ont été déjà réalisés l’histoire d’un officier français, né en 1910, publiée sous le titre La dernière marche de l’Empire, une éducation saharienne aux éditions La Découverte en 2009. Puis, le récit de la fille de goumier maure née en 1940, Mariem donc, paru sous le titre La fille du chasseur. Il me reste à présent à terminer la rédaction du témoignage d’un ancien tirailleur Haalpulaar, né en 1920. J’ai rencontré Moussa Wagne, du village de Sayé près de Boghé, en 2005 et entrepris avec lui puis, après sa mort, en 2009, auprès de ses parents, une série d’enregistrements que j’ai depuis lors décryptés et travaillés. Ce nouveau livre que j’ai intitulé « Les Sept Cercles » devrait sortir très prochainement aux Editions Thierry Marchaisse.
Ces trois récits seront accompagnés d’un quatrième ouvrage, plus scientifique, qui reviendra sur les conditions dans lesquelles j’ai mené ces différentes enquêtes, les méthodes de travail et d’écriture que j’ai adoptées pour réaliser cette trilogie. Il proposera, en outre, une analyse anthropologique de ce que cette mise en perspective des trois points de vue apporte à la connaissance de la relation coloniale, telle qu’elle s’est construite en Mauritanie, et ce qu’elle a provoqué.
Quand avez-vous visité la Mauritanie, pour la première fois ?
Je suis venue en Mauritanie, fin 1974, pour faire la première d’une série d’enquêtes de terrain sur les Rgaybat qui m’ont permis plus tard de soutenir ma thèse d’Etat dont les deux volumes, Les Rgaybat 1610-1934, sont parus aux éditions L’Harmattan avec une préface de Théodore Monod. Quelques années plus tard, dans une perspective épistémologique, j’ai relaté, de manière littéraire, cette première rencontre dans Les enfants des nuages, parus aux éditions du Seuil, avec une préface de Jacques Berque, en 1993
Le pays a-t-il changé à vos yeux ?
Comme aux yeux de tout le monde, évidemment ! A Nouakchott, vous dites détester aller à l’hôtel ! Je n’ai pas dit que je détestais aller à l’hôtel ! A ceux qui me demandent, souvent, à quel hôtel je suis descendue, je réponds que le jour où je devrai aller à l’hôtel en Mauritanie, je n’aurai plus de raison de venir dans ce pays. Car si cela arrivait, cela signifierait que je n’aurai plus de famille pour m’accueillir, ni plus d’amis pour m’accueillir, donc plus rien ici. Pour moi, l’important ici, c’est la qualité des relations que j’entretiens avec les gens. Le reste, c’est… du sable.
Quelle est votre occupation actuelle ?
Comme je vous l’ai dit, je dois terminer cette trilogie coloniale, finaliser le troisième livre. Ensuite reprendre le premier, car mon éditeur actuel, qui fut pendant trente ans directeur des collections de Sciences Humaines aux Editions du Seuil, et vient de monter sa propre maison, les éditions Thierry Marchaisse, souhaite publier l’ensemble sans pour autant faire de doublon avec une précédente publication. Je dois également écrire ce volume de présentation et d’analyse qui accompagnera les trois récits.
Thierry Marchaisse est en train de republier un ouvrage épuisé, Les non-dits de l’anthropologie, que j’ai retravaillé et dont une version espagnole sortira aux Editions d’El Oriente y de la Mediterraneo qui a traduit Les enfants des Nuages il y a quelques années. Avec tout ça j’ai pas mal de pain sur la planche, en matière d’écriture, pour les prochaines années !
Mais parallèlement, je me préoccupe de transmettre à la jeune génération un outil de travail pour développer les recherches sur la Mauritanie. Avec un jeune collaborateur italien, Francesco Correale, qui vient d’être intégré à mon laboratoire, nous avons conçu en collaboration avec certains de nos collègues européens et mauritaniens un grand projet de Bibliothèque Digitale Multilingue des Sources Inédites de la Mauritanie, Biblimos, qui pourrait, s’il est financé, permettre la multiplication des échanges entre l’université de Tours et l’université de Nouakchott, et surtout l’accès par Internet de tous les jeunes chercheurs à des sources d’archives difficilement accessibles et pourtant indispensables pour revisiter l’histoire de la Mauritanie, de sa société et de sa culture.
Propos recueillis par Bios Diallo