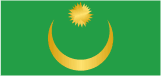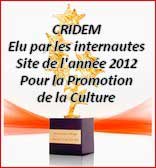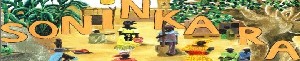25-12-2020 00:00 - Notre jeunesse qu’en dire: Inquiétude, Calamité ou Espoir ?

Abdou Karim Gaye - Selon le blogueur Bouacar Bouaré : « L’avenir d’un pays, d’un continent, dépend de ses jeunes. L’avenir, c’est la jeunesse. L’avenir, c’est pour la jeunesse. L’avenir, c’est par la jeunesse. » En quelque sorte, l’auteur a donné à la jeunesse un profil de Maitre d’Œuvre responsable du devenir des nations.
Evidemment, les potentialités de la jeunesse à assumer ces lourdes responsabilités ne sont pas mises en cause. La question préoccupante ici est relative à la performance des jeunes. Plutôt, l’image reflétée par la jeunesse du continent qui souffre de mal-développement et d’instabilité politique, particulièrement dans la région subsaharienne où sévit une extrême pauvreté.
La jeunesse désigne communément le temps de vie entre l’enfance et l’âge adulte. Plus précisément, les Nations Unies définissent « jeune » comme une personne âgée de 15 à 24 ans. Force est de constater que cette définition ne fait pas l’unanimité.
Certaines organisations ont étendu l’âge des jeunes à 30 ans, voire 35 ou même plus. Le cas échéant, on parle de jeune-adulte. La jeunesse est une classe attrayante. Elle subit de manière fréquente l’intrusion des membres d’office d’autres classes (enfant, adulte et vieillesse) cherchant par tous les moyens à s’assimiler aux jeunes.
De même, des d’adultes et vieillards trahis par leurs traits physiques aiment revivre leur jeunesse dans l’imaginaire en se remémorant des beaux souvenirs ou ressasser des regrets. Ceux-ci confirment le rôle déterminant de la jeunesse dans le cycle de la vie, un âge d’or à prendre trop au sérieux.
Le bilan de performance de la jeunesse en un temps donné est la somme des performances de toutes les générations de jeunes qui se sont succédées jusqu’à cette date. Il va s’en dire que le niveau de développement actuel de l’Afrique s’explique par le fait qu’une ou plusieurs générations de jeunes ont manqué d’atteindre leur pleine potentialité au cours de l’histoire.
Pourtant les jeunes d’Afrique ont pris une avance confortable au départ. Des chercheurs africains de renom ont prouvé de manière objective et acharnée que l’Afrique est le berceau de l’humanité. Donc, ils étaient seuls sur terre au tout début à challenger la nature pour satisfaire leurs besoins fondamentaux de survie.
Ces premiers jeunes se servaient des mêmes capacités physiques, d’imagination et de créativité pour prouver leur statut de maître sur terre. Malgré cet avantage, ils sont les derniers au bout du compte.
La performance de la jeunesse dans le texte est comparable à la course de relais. Celle-ci consiste à demander aux sprinteurs d’atteindre et conserver leur vitesse maximale dans la course individuelle et durant la transmission du témoin entre le relayeur et le receveur jusqu’à la ligne d’arrivée.
Le jeu repose sur une logique d’anticipation, de réaction rapide et de coordination entre différentes vitesses, en vue d’atteindre un but commun. La perte de vitesse accusée par un sprinteur se répercute sur la performance globale.
A ce stade actuel de l’histoire des peuples d’Afrique, il est tout à fait légitime de chercher à trouver des explications sur les pertes de vitesses de la jeunesse, à l’effet d’en tirer des leçons.
Ce qui est sûr, plusieurs jeunes africains ont abandonné, bon gré mal gré, leur équipe en pleine course pour renforcer les équipes adverses, notamment dans le cadre de la traite négrière, la colonisation et l’émigration. Ces quelques exemples sont utilisés par bon nombre de jeunes africains comme alibis pour justifier le retard de l’Afrique.
A y voir de plus près, ces fléaux sont des risques ou obstacles comme tant d’autres inhérents au projet de développement.
D’ailleurs, l’Afrique n’est pas le seul continent à souffrir de pertes humaines de masse au cours de son histoire. L’Europe a connu une peste noire au moyen âge tuant environs 50 millions de personnes en cinq ans. Une hécatombe ayant engendré de lourdes conséquences socio-économiques mais l’Europe a fait preuve de résilience.
La mauvaise expérience a permis aux européens de redéfinir leurs modèles économiques et sociétaux les rendant plus puissants que jamais, une bonne leçon du leadership humain.
Aujourd’hui, tous les espoirs sont placés sur la jeunesse africaine actuelle pour reprendre la main avec une nouvelle donne. La responsabilité de la jeunesse est devenue plus importante du fait de l’héritage du passif des générations passées. Elle a un défi de reconstruction d’une Afrique indépendante matériellement, moralement et intellectuellement.
Le pari parait difficile à réaliser dans un contexte mondial marqué par des enjeux liés à la globalisation et aux mégatendances qui sont des opportunités pour les pays développés d’asseoir un pouvoir de contrôle permanent sur les pays sous-développés.
Alors, il y a vraiment de quoi s’inquiéter sur l’avenir de l’Afrique avec surtout le taux de chômage élevé chez les jeunes, d’autant plus que le chômage cache des contrariétés inavouables.
C’est en Afrique qu’on trouve des zones habitables touchées par la sécheresse ou subissant d’autres catastrophes naturelles récurrentes répondre par le même mode opératoire, à savoir lancer des cris de détresses pour bénéficier de l’aide nationale et internationale au lieu de trouver une solution pérenne.
Au pire des cas, les jeunes de ces localités désertent les lieux en laissant derrières des personnes vulnérables pour tenter leur chance dans des agglomérations urbaines sans toujours trouver mieux.
Ironie du sort, dans des zones bénies par la nature se trouvent des jeunes nonchalants croisant les bras et accusant leur gouvernement de non-assistance alors qu’ils vivent à côté d’une source d’eau abondante et poissonneuse, une forêt enviable et des terres cultivables.
Le comble est de voir un nombre croissant de parents s’activer sur le marché de l’emploi à la place de leurs enfants pour négocier des postes en leur faveur au moment où ceux-ci se la coulent douce.
L’on dirait que la dépendance des jeunes s’est érigée en culture et que la capacité innée de l’homme à braver son environnement avait disparu chez eux. Il ne s’agit pas là d’un procès mais de constats choquants, une désolation face à l’effritement d’une force de travail de qualité rare.
Il est sans doute vrai que le chômage endémique a des effets nuisibles à l’homme. L’exemple de la jeunesse africaine peut bien illustrer cette affirmation avec le phénomène de la migration des jeunes vers l’Europe au risque de leur vie.
D’énormes efforts ont été déployés par les pays envahis pour tenter d’endiguer ce phénomène au travers la mise en place de programme d’insertion locale, publication d’images horribles montrant des corps jonchés sur les côtes océaniques et le désert, des reportages sur la situation des camps de rétention des émigrés capturés ainsi que les films de rapatriements en masse, etc.
Tous ces plans n’ont pas eu d’effets réels sur la détermination des jeunes à suivre leur impulsion instinctive de faire ou refaire l’expérience.
D’autre part, des jeunes désœuvrés choisissant de rester au pays participent à la moindre occasion à des activités incommodantes, telles que les émeutes, vols, groupes armés ou terrorismes sans pour autant être capable d’expliquer les raisons objectives les ayant poussés à s’impliquer dans ces types d’activités.
En effet, il est probable ou même certain que le chômage chronique ait développé chez ces jeunes un sentiment d’exclusion et d’inutilité dans la société. La déchéance mentale fait ainsi basculer leur champ d’énergie humaine dans la zone négative.
Ce qui se solde par des réactions contraires à la norme, en l’occurrence maudire leur pays ou voir un avenir sombre tout autour. Dans cette situation, ils ne font pas la différence entre la vie et la mort.
Ces jeunes n’hésitent pas à s’aventurer dans un périple offrant 1 % de chance de survie car leur désir de changer de situation à tout prix l’emporte sur la raison. Une fois à ce point, ils deviennent de véritable bombe à retardement capable des pires actes criminels et pouvant déstabiliser n’importe quel système d’organisation ou pays. Qui donc a intérêt à les aider à transformer leur énergie négative en énergie positive ?
En dehors de tous les aspects négatifs susmentionnés, une lueur d’espoir se dessine sur le continent africain. Le Rwanda, « miracle d’Afrique », est un exemple typique de résilience africaine post-traumatisme. Un pays meurtrit par une guerre civile atroce qui s’est reconstruit dans un temps record jusqu’à se hisser parmi les meilleures performances économiques du continent.
La question du mérite des jeunes est certainement posée dans le cas du Rwanda. En réalité, un changement en Afrique échapperait difficilement au contrôle de la jeunesse avec son pourcentage considérable dans la population et sa forte capacité de mobilisation des électeurs devant élire les dirigeants.
En fin, l’Afrique est la région la plus jeune au monde, contrairement aux autres continents qui souffrent du problème de vieillissement de leur population. Cette aubaine démographique est une opportunité inédite de développement économique. Mais une fois encore, la jeunesse va-t-elle saisir l’opportunité et provoquer le changement tant espéré ou attendra-t-elle que les conditions soient réunies pour agir?
Une jeunesse proactive provoquerait forcement une chance de renverser la tendance. Toutefois, les gouvernants devraient être assez sages pour amener les jeunes à se découvrir et les laisser accomplir leur mission au lieu de mettre en place des programmes déconnectés de la réalité de leur état d’esprit.
En ce sens, le laboureur avait une connaissance parfaite de la motivation de ses fils et ses conseils étaient plus que productifs : « Travaillez, prenez de la peine… Creusez, fouiller, bêchez ; ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse… le TRAVAIL est un TRESOR. » Jean de La Fontaine.
Abdou Karim Gaye
HR/Développement Personnel
Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité.