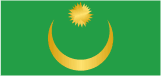21-01-2016 00:00 - Dr Mariella Villasante : Le passé colonial et les héritages actuels en Mauritanie (2)

Adrar-Info - Première Partie Problèmes conceptuels et de méthode
• Dans le premier chapitre (Villasante a), j’ai analysé le devenir des catégories coloniales de classements collectifs : « les races, les tribus et les ethnies », qui légitimèrent l’esclavage africain d’abord, puis l’expansion coloniale.
J’ai proposé également que le flottement qui caractérise l’emploi des termes « ethnie » et « tribu » dans la production anthropologique française est associé à la persistance des idées coloniales dans les travaux de certains spécialistes.
Après avoir présenté une critique de certains travaux des auteurs « orientalistes », qui reprennent à leur compte les données coloniales, j’ai examiné les héritages des classements coloniaux et leurs manipulations au sein des élites mauritaniennes.
« Dans cet essai, je tenterai d’examiner les implications conceptuelles de ces classements occidentaux, qui se rattachent aux liens sociaux fondés sur les origines communes, en distinguant soigneusement trois niveaux d’occurrence linguistique et sémantique : celui de l’administration coloniale, celui du langage ordinaire (repris par les médias et par les élites politiques africaines) et enfin celui des spécialistes modernes.
Cet exercice de déconstruction des catégories de classement coloniales me mènera à suggérer, d’abord, que contrairement à l’idée répandue qu’elles furent issues de l’expansion coloniale et impérialiste du XIXe siècle en Afrique, aux Amériques et en Australie, ces catégories plongent en fait leurs racines dans une idéologie européenne forgée progressivement dès l’époque des « découvertes des nouveaux mondes ».
En France, l’idéologie de la hiérarchie des races supérieures et inférieures émergea dès le XVIIe siècle et devint scientifique au XIXe siècle. Elle légitimera l’esclavage africain d’abord et l’expansion coloniale ensuite.
La deuxième proposition de ce texte est que le flottement qui caractérise l’emploi des termes ethnie et tribu dans le milieu anthropologique actuel n’est pas étranger à la persistance des idées coloniales parmi certains spécialistes.
Une forme de nostalgie orientaliste (au sens de Said 1978) traverse en effet certains travaux francophones faisant autorité sur les sociétés de l’Afrique subsaharienne, de l’Afrique du nord et du Proche-Orient. Une critique directe, même si elle ne fait pas partie des habitudes universitaires en France, semble cependant indispensable si l’on veut dépasser ce stade conservateur de la recherche fondamentale.
Après avoir exposé ces observations distancées, je présenterai quelques suggestions sur la pertinence des concepts en question et avancerai quelques pistes de recherche.
En particulier, à la place du terme ethnie, je suggère de parler de groupes ethniques et de leurs frontières (au sens de Barth, 1969), et de groupes unis par la parenté, tous deux placés dans le cadre étendu des identités sociales élargies et des identités sociales restreintes (variant selon les niveaux nationaux, régionaux ou locaux considérés).
Pour conclure, j’évoquerai quelques héritages néfastes des classements coloniaux en Afrique contemporaine, dans leurs dimensions essentialistes et racistes, pour souligner la manipulation dont ils font l’objet de la part des élites africaines au pouvoir. » (pp 60-61).
Campement d’officiers français à Akjoujt, Adrar, c. 1934 (Collection Hamody)
• Une autre notion d’invention coloniale, « l’islam noir », est analysée par l’historien Christopher Harrison [a, chapitre 2], telle qu’elle fut construite par trois administrateurs de l’Afrique occidentale française durant la Première Guerre mondiale, François Clozel, Maurice Delafosse et Paul Marty.
Les interprétations de ces administrateurs influencèrent les Européens et les dirigeants politiques africains dans un contexte marqué par les luttes des Alliés contre l’Empire Ottoman, et par le recrutement des soldats Africains musulmans pour la plupart.
L’islam noir fut ainsi défini comme une religion distincte de l’islam arabe car il était « coloré » par une « culture indigène » et par les « traditions ethniques africaines ». D’après eux, les Français devaient avoir une stratégie double de protection des religions africaines contre l’intrusion islamique, et d’alliances avec les chefs musulmans dans les régions à dominance islamique.
« Cette étude décrit les premières analyses des Français sur la nature de leur présence en Afrique de l’ouest. Au cours de la Première Guerre mondiale, certains administrateurs avaient déjà acquis un savoir considérable sur les sociétés « indigènes » et, durant les années de guerre, suite aux initiatives de l’administration coloniale, il augmenta dans des proportions considérables.
Trois hommes, en particulier, furent responsables de ce déploiement d’activité : François Clozel, Maurice Delafosse et Paul Marty. Bien que tous trois travaillaient pour le bénéfice du système colonial, ils contribuèrent malgré tout à une certaine interprétation de la société africaine qui influença profondément les Européens et les dirigeants politiques africains.
Cette interprétation plaçait l’islam dans une position centrale : sa nature fut redéfinie au sein d’une analyse de la culture africaine qui mettait en avant la force des « traditions ethniques » dans le cadre d’une société en construction.
La définition française de l’islam noir, en tant que religion distincte du type d’islam pratiqué ailleurs dans le monde musulman, acquit une signification particulière dans le contexte de la Première Guerre mondiale, alors que l’Empire Ottoman s’opposait aux Alliés.
La pression sur le gouvernement colonial augmenta sensiblement lorsque les Africains furent enrôlés, à la fois directement et indirectement, pour aider les Alliés dans leur effort de guerre en Europe de l’ouest. La réponse des musulmans de l’ouest africain à cet effort devint une question d’importance fondamentale. » (Harrison 2014 : 115).
Mokhtar Ould Dah, des Awlâd Abyairi, 1936 (Delcampe)
• James Searing [chapitre 3], historien, examine les problèmes méthodologiques liés à l’étude de l’ordre mouride au Sénégal, mais qui est également présent en Mauritanie. Il avait été classé par les colonisateurs français comme une « branche bâtarde de l’islam noir ».
D’après les interprétations coloniales françaises, l’ordre confrérique mouride poursuivit une résistance passive à la monarchie wolof après que les troupes coloniales aient tué le Lat Joor [dammel, roi] en 1886. Searing s’oppose à ces manières de voir et avance que les rapports officiels qui ont guidé le travail de certains chercheurs contiennent des erreurs dues à l’ignorance des Français, mais aussi d’autres erreurs conscientes destinées à manipuler les faits.
À partir d’une lecture critique des archives coloniales, mais surtout des sources mourides orales, Searing propose une nouvelle interprétation de l’arrestation du chef de l’ordre mouride, Amadou Bamba, en 1895, et remet en question l’importance accordée aux sources écrites dans les recherches contemporaines.
« Les historiens et les sociologues ont interprété l’arrestation et l’exil d’Amadou Bamba, savant et chef confrérique, en 1895, dans le contexte de la politique coloniale française vis-à-vis de l’islam. Les documents d’archives de l’année 1895 ont fourni les bases de cette interprétation due à l’émergence de l’ordre mouride, qui relie Amadou Bamba à Lat Joor, le dernier roi wolof indépendant du Kajoor.
À l’encontre des règles coloniales, l’islam mouride semblait ainsi poursuivre l’opposition à la monarchie en développant une nouvelle forme de « résistance passive » succédant à la résistance armée, après que les troupes coloniales aient tué Lat Joor en 1886.
Cette étude s’oppose à ces interprétations en s’appuyant sur une lecture critique des sources d’archives et sur l’utilisation des données mourides – dont des sources écrites publiées, des entretiens de savants mourides et des enregistrements de séances publiques des « prêcheurs populaires » [convertis en bardes, géwél].
Je voudrais avancer ici que les rapports officiels qui ont guidé les interprétations des chercheurs sont imparfaits. Ils contiennent à la fois des erreurs factuelles basées sur l’ignorance des faits de la part des Français et des erreurs conscientes, destinées à renforcer les rumeurs et les rapports des informateurs qui en constituent l’unique base.v Les archives ne révèlent pas non plus une politique cohérente ou un rôle actif des Français. Elles suggèrent plutôt que les chefs wolof, qui signèrent les traités avec les Français en 1883, furent les véritables instigateurs de l’arrestation d’Amadou Bamba. » (Searing 2014 : 161).
Amadou Bamba, 1913
• Le problème du langage d’autorité politique et de ses traductions en Mauritanie précoloniale est étudié par Raymond Taylor [a, chapitre 4], historien. Il explore la logique du dialogue dans la rencontre entre les officiels Français et les guerriers nomades dans la vallée du fleuve Sénégal durant les premiers temps de l’expansion impérialiste.
Son étude se fonde sur un riche corpus de lettres échangées entre les Gouverneurs de Saint-Louis et les « émirs » des régions du Trârza et du Brâkna, ou gebla mauritanienne.
Concevant ces échanges comme des « rencontres de persuasion mutuelle », Taylor suggère que chacune des parties cherchait à interpréter son propre ordre social de manière à ce qu’il résonne avec les valeurs de l’autre, tel qu’elles étaient comprises par les interlocuteurs eux-mêmes. Bien évidemment, les incompréhensions étaient endémiques.
Cependant, l’invention des traditions était ici le plus souvent une invention personnelle, c’est-à-dire la réinterprétation consciente de sa propre culture motivée par le désir de persuader l’Autre.
Les communications étaient remplies de méprises, mais de ce flux d’interprétation et de déformation de sens émergea un discours commun, une lingua franca, sur l’autorité, le pouvoir et la légitimité, qui évolua en changeant les perceptions des Français mais aussi des Bidân de la gebla sur leurs propres systèmes politiques.
« En août 1848, Muhammad al-Rajil s’adressa officiellement au Gouverneur (wâli al-nasârâ) de Saint-Louis, siège de la colonie française situé à l’embouchure du fleuve Sénégal.
En tant qu’amîr des guerriers Brâkna, il demandait le solde des coutumes, ou péages commerciaux, que les marchands de Saint-Louis lui devaient. (…) Les administrateurs français considéraient les hassân du Trârza et du Brâkna comme une aristocratie barbare, une caste de guerriers dirigés par des rois héréditaires dans un contexte d’anarchie féodale. (…)
De telles oppositions conceptuelles caractérisaient toutes les interactions entre les autorités françaises et la population de la gebla précoloniale. Des milliers de lettres, comme celle qui vient d’être citée, sont conservées dans les archives coloniales, dont plusieurs centaines sont en arabe avec des traductions en français contemporain.
Ce corpus constitue un ensemble riche d’incompréhensions interculturelles. Plus encore, il met en lumière l’effort continu de communication à travers un large fossé discursif. Dans leurs tentatives pour franchir cet abîme, les populations de la gebla et les autorités de Saint-Louis tentaient d’influencer, de complimenter et de persuader.
Leurs messages n’étaient pas simplement destinés à exprimer leurs idées mais également à le faire d’une manière compréhensible pour leurs interlocuteurs. Qu’une autorité française comme Reverdit reste ferme dans sa défense de la succession dynastique des Brâkna pendant l’été 1848, à une époque où les décombres des barricades jonchaient les rues de Paris, suggère autre chose qu’un simple cynisme.
Le Directeur des Affaires étrangères croyait lui-même traiter avec des monarques féodaux et agissait conformément à cette idée. Il remplissait le fossé de son incompréhension de la politique de la gebla en l’alimentant par sa propre connaissance de l’histoire monarchique européenne. Les chefs de la gebla faisaient de même, s’adressant en retour aux autorités françaises comme à des chefs de guerre affiliés ou à des subordonnés indisciplinés.
Les communications qui circulaient de part et d’autre, de Saint-Louis à la gebla, témoignent d’un flux continuel de traductions, d’interprétations et de méprises. Par ailleurs, ceux qui communiquaient cherchaient à introduire des conceptions subtiles sur l’autorité, le pouvoir et la légitimité, de manière à être en accord avec les conceptions supposées de leurs interlocuteurs qui, le plus souvent, ne leur étaient qu’imparfaitement connues.
De ce flux d’interprétations et de déformations de sens, de communications et d’incommunications, émergea bientôt un discours commun, une lingua franca, qui évolua au cours du temps en changeant les perceptions et les intérêts des deux bords.
Cette lingua franca était aussi ancienne que le commerce de la gomme et elle continua à se développer au cours du XIXe siècle. Au bout de quelques décennies, il y eut des changements perceptibles dans la manière dont les deux côtés discutaient des affaires d’autorité. La terminologie se stabilisa. Des traductions standard émergèrent pour des formules communes.
Des demandes fréquentes, des aides et des menaces s’articulèrent avec une plus grande consistance. Cependant, comme toute autre lingua franca, ces discours conjoints reflétaient moins les propos internes des deux côtés qu’une accumulation de compromis négociés au cours du temps. » (Taylor 2014 :181-183).
Mohameden Ould Haibou (maître des langues, premier à gauche)
avec un administrateur français et un notable, c. 1930 (Collection Hamody)
• Les discours coloniaux sont également examinés par Ann McDougall [chapitre 5], historienne, qui consacre son étude à l’examen des textes sur le travail et la classe ouvrière en Mauritanie dans la période de l’entre-deux-guerre et au cours de la Seconde Guerre mondiale.
Consciente du fait que la recherche d’une classe ouvrière dans les sources coloniales peut être perçu comme une tâche passéiste ou comme un travail impossible dans le contexte de recherche postmoderne et postcolonial, plutôt intéressé aux discours et aux déconstructions, McDougall avance que le problème reste posé dans la mesure où le travail manuel reste accompli par les mêmes groupes de « travailleurs » issus des groupes serviles de la Mauritanie contemporaine.
À partir d’une perspective qui privilégie la relation entre les maîtres et les esclaves, elle aborde ces questions à la lumière des données d’archives et des entretiens sur l’esclavage endogène, sur la référence islamique comme source de légitimation de cette pratique, et sur l’émergence d’une nouvelle classe des travailleurs « hrâtîn » ; elle avance enfin que ces derniers avaient une conscience identitaire distincte de celle des esclaves (‘abîd).
Groupe de femmes de statut servile c. 1948 (Collection Hamody)
• Alberto López Bargados [chapitre 6], anthropologue, s’attache à présenter une analyse comparative des représentations des Espagnols et des Français sur l’ordre social des Bidân de la région du Sahara occidental et du nord de la Mauritanie, entre la fin du XIXe siècle et la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Ces représentations étaient associées à l’action coloniale et aux stratégies de commandement, mais aussi à l’histoire spécifique de la France et de l’Espagne. L’auteur avance que le Sahara occidental était d’un intérêt limité pour l’Espagne qui tentait encore de conserver ses dernières colonies américaines (Cuba et Puerto-Rico) et les Philippines.
Lors du partage de l’Afrique, l’Espagne avait obtenu seulement trois territoires : le Sahara, la Guinée Équatoriale et quelques territoires au nord du Maroc. Sa situation était bien différente de celle de la France qui avait obtenu des territoires considérables.
Or, les administrateurs espagnols qui géraient une zone restreinte en nombre de « sujets » et qui ne s’intéressaient pas aux modèles globaux comme les Français, firent des observations plus proches de la fluidité qui caractérisait les hiérarchies sociales des Bidân, et assez éloignées de la rigidité statutaire qui séparait, d’après les Français, les groupes guerriers et les religieux.
« Dans cette contribution, il s’agira de réviser la représentation que les administrateurs coloniaux français et espagnols se firent de l’ordre social bidân, en particulier du système complexe des rangs et des hiérarchies des groupes de parenté bidân (qabâ‘il, sg. qabîla).
Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais préciser un point, à mes yeux très important : les systèmes coloniaux français et espagnol, profondément différents l’un de l’autre, n’arrivèrent jamais à se cristalliser comme des modèles heuristiques à proprement parler ; et dans le cas espagnol, il ne put même pas acquérir des profils clairs et nets.
De fait, les représentations des deux administrations ne furent pas soumises à un processus de falsification scientifique nécessaire pour justifier et pour fonder un corpus systématique de recherches. En réalité, les perceptions élaborées sur le système statuaire bidân agirent comme un cadre conceptuel ou une carte de coordonnées, sur lequel on pouvait disposer les différents groupes sociaux.
Ces représentations étaient étroitement associées à l’action coloniale, soit parce qu’elles étaient instrumentalisées par cette action, soit parce que cette dernière fut influencée a posteriori, exerçant ainsi un ascendant direct sur la politique développée sur le terrain.
C’est dans ce sens que je suggère ici de parler de deux politiques de perception, clairement distinctes l’une de l’autre. Il serait difficile d’offrir une version unique de ces représentations déployées au long du temps ; cependant, il est possible au moins de nous approcher du moment auquel elles furent organisées et mises sur la scène saharienne, en signalant les malentendus, parfois néfastes, qu’elles ont générés.
On tentera de remonter dans le temps jusqu’à l’époque où ces idées furent forgées, en examinant le contexte politique et intellectuel du moment, tout en inscrivant quelques bases minimales pour mieux comprendre les fondements respectifs. » (López Bargados 2014 : 238-239).
Soumission des Rgaybat, 1958 (Collection Hamody)
• Dans le chapitre 7, (Villasante b), j’aborde les malheurs de l’influence coloniale dans la construction du passé historique de la Mauritanie contemporaine. Malheurs car les administrateurs coloniaux inventèrent une « histoire mauritanienne » biaisée par leurs propres idéologies sur ce que devait être une nation selon le modèle français.
Les producteurs de l’histoire de Mauritanie ont été influencés pendant longtemps par les conceptions et les stéréotypes forgés par les auteurs coloniaux et néocoloniaux qui ont privilégié les distinctions sociales fondées sur la « race », l’histoire-traités-batailles, la rigidité des hiérarchies sociales distinguées en « trois ordres », guerrier, religieux et tributaire, et enfin l’invention d’un passé politique « centralisé », les « émirats ».
Plus pernicieuse encore fut la correspondance établie sur le plan politique entre le « peuple bidân » et le « peuple mauritanien », qui relègue dans un second plan les communautés africaines halpular’en, soninké et wolof, correspondance reprise par les gouvernements mauritaniens, et qui reste une source de tension ethnique et nationale importante dans le pays.
« (…) si d’un point de vue culturel l’identité bidân s’est construite autour de l’utilisation d’une même langue, le hassâniyya (variante arabe de l’ouest saharien mélangée au berbère local, le znâga), elle ne correspondait pas à une identité politique fondée sur la reconnaissance d’un même pouvoir politique centralisé et légitimé. Autrement dit, l’appartenance à l’ensemble culturel et linguistique bidân n’impliquait pas une interdépendance politique globale.
Ainsi, il n’y avait pas de « société politique bidân » à proprement parler (c’est nous, universitaires, qui utilisons cette abstraction identitaire dans nos discours académiques), mais simplement divers groupes de parenté bidân, unis par la filiation et par l’alliance politique (qabâ‘il, sg. qabîla), distingués en fonction de leur insertion régionale et de leurs statuts collectifs.
L’organisation politique des Bidân avant l’arrivée des colonisateurs impliquait également l’existence de coalitions, de confédérations et d’alliances entre divers groupes régionaux en fonction des objectifs politiques à court et à long terme, dans un contexte marqué par la fluidité des relations sociales et du pouvoir politique.
J’ai identifié trois grands ensembles régionaux ayant des histoires et des parcours culturels communs : la gebla au sud-ouest, influencée par les royaumes wolof ; l’Adrâr et le Sahel atlantique au nord, jusqu’à la Sâqiya al-Hamrâ, frontière culturelle avec les Berbères marocains ; et enfin le sharg, l’Est, englobant le Tagânet, l’Assâba et le Hawd, jusqu’aux frontières culturelles et d’habitat des Touareg de l’Azawâd et des groupes mandé et songhay du nord du Mali (Villasante Cervello 2003b : 3-9). (…)
Ce texte est divisé en trois parties. Dans la première, je tenterai d’éclaircir un tant soit peu la vaste question des sources historiques et des historiens locaux, qui nous vient immanquablement à l’esprit lorsqu’on aborde le thème de l’histoire d’un peuple nouvellement constitué comme les Mauritaniens.
Dans la seconde partie, je présenterai une description analytique de l’œuvre de trois auteurs coloniaux qui ont influencé et influencent encore les travaux historiques mauritaniens, il s’agit de Georges Poulet, de René Basset et de Paul Marty.
Cette influence sera illustrée, dans la troisième partie, à travers l’analyse des travaux de trois chercheurs contemporains, Charles Stewart, Abdel Wedoud ould Cheikh et Pierre Bonte. J’évoquerai, pour conclure, quelques traits de la nouvelle histoire mauritanienne en voie de construction. » (Villasante 2014 : 263-264).
Premier conseil de ministres de Mauritanie, Nouakchott, le 12 juin 1957 (Musée national de Mauritanie)
[Gouverneur Albert Mourague, Ahmed Salem Ould Hayba, Ould Sidi Baba, Mokhtar ould Daddah, et Amadou Diadié Samba Diom]
A suivre …./
Le passé colonial et les héritages actuels en Mauritanie État des lieux de recherches nouvelles en histoire et en anthropologie sociale
Sous la direction de Mariella Villasante Cervello Avec la collaboration de Christophe de Beauvais Séminaire au Centre Jacques Berque Rabat le 12 janvier 2015 Dr Mariella Villasante Cervello [academia.edu]