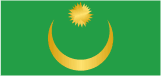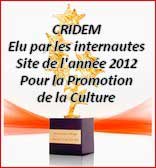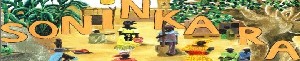16-05-2017 17:16 - Avis de parution : La résistance pacifique, Roman par Mamadou Kalidou BA

Editions.Harmattan - Le récit se déroule dans un pays biracial et multiculturel dénommé Harfusowo, une contrée qui ressemble fort à la Mauritanie, la patrie de l’auteur. Cinq ethnies, partageant quatre langues (l’Ar, le Fu, le So et le Wo), en plus du français, cohabitent difficilement dans un territoire pourtant très spacieux. L’ethnie H, de loin la plus aisée, est de langue ar et de race noire.
Les différents pouvoirs qui se sont succédé à la tête du pays, ayant été dominés par des lobbys racistes appartenant à la minorité raciale ar, ont exacerbé les divisions au point de radicaliser les populations noires qui luttent pour l’avènement d’un Harfusowo débarrassé des démons du racisme et de l’esclavage.
Le WEJ (mouvement politique négro-africain) et l’AM (mouvement abolitionniste H) s’affirment comme les fers de lance d’une lutte non violente. S’inspirant de Martin Luther King et de Gandhi, des leaders d’une nouvelle génération ne reculent devant rien pour vaincre l’esclavage et le racisme d’Etat.
Mais ceux qui gouvernent le Harfusowo sauront-ils écouter la grogne d’une majorité longtemps restée silencieuse ? Dans cette âpre lutte pour l’égalité des hommes, l’amour qui unit Gayel à Raky porte autant d’espoir que la lutte non violente.
L’Auteur
Enseignant-chercheur à l’Université de Nouakchott, en Mauritanie, Mamadou Kalidou BA est le Chef du Groupe de Recherches en Littératures Africaines (GRELAF) et coordinateur du Master de Lettres modernes francophones à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines.
S’il signe là sa première oeuvre romanesque, il est déjà auteur de nombreux articles et ouvrages critiques publiés dans des revues scientifiques et aux éditions L’Harmattan.
Extraits
« La cohabitation entre les peuples négro-africains, berbères et arabes a été très fructueuse au plan commercial, culturel et religieux, mais elle s’est également traduite par de nombreuses confrontations faites de pillages et de guerres de religion.
Le commerce et le pillage ont soumis aux affres de l’esclavage, des milliers d’hommes et de femmes noirs, brutalement enlevés à ceux qui leur étaient chers et déportés dans des contrées lointaines. Ils ont été vendus ou troqués contre de simples objets de décoration comme un collier, un simple caprice de goût comme une barre de sel ou l’orgueil d’un riche seigneur comme un bout de soie offert à une maitresse.
Pendant plusieurs milliers d’années, des générations d’esclaves se sont transmis des chromosomes de plus en plus endurcis pour survivre à la souffrance et à l’humiliation, au point de constituer, à leur propre insu, un inconscient collectif dans lequel la violence, la brutalité et le désespoir sont configurés en plusieurs couches de sédiments.
Seuls les plus endurants pouvaient survivre. Comment peut-on, dès lors, rationnellement et justement s’arrêter à une simple condamnation de ces groupes de H ? Je ne dis pas qu’il faille excuser leur forfait – ce qui reviendrait à leur dénier toute responsabilité et donc toute humanité – mais je dis que la solidarité humaine nous impose d’appréhender ces hommes et leurs agissements sous le prisme continu de l’évolution diachronique de notre Humanité.
Une oppression en engendre toujours une autre, d’une manière discontinue certes puisque le psychisme humain ne se paramètre pas en données algébriques.
Tel un volcan arrivé à maturation qui vomit sa lave, le trop-plein de frustration s’exprime toujours par une vigoureuse manifestation de colère, si ce n’est de folie. » (P.62-63) Toute tentative d’exclusion d’une de ces langues porteuses d’une partie fondamentale de notre culture diverse, est non seulement vouée à l’échec, mais exposerait également notre patrie à des tensions dangereuses pour son avenir.
Il n’y a pas de langues supérieures et d’autres inférieures sous le prétexte fallacieux que les premières ont servi à véhiculer une religion ou vulgariser certaines sciences alors que les secondes n’ont pas eu ce hasard de l’histoire.
Ce n’est pas la sacralité ou la scientificité d’une langue qui détermine sa valeur intrinsèque, mais sa capacité à assurer la pérennité de la civilisation qui l’a engendrée et l’intégrité des membres de la société dont elle est le véhicule de l’être vital, autant dire de l’âme constamment remise au goût du jour.
L’Ar ou le yiddish ne sont pas supérieurs au Fu ou au So, pas plus que le latin, le grec, l’anglais, le chinois, le russe ou le français ne peuvent se targuer de supériorité sur les autres langues de l’humanité à cause du nombre de leurs locuteurs ou de leur disposition à diffuser les sciences nouvelles.
La science et la religion servent l’homme, à condition que l’une et l’autre soient appréhendées à travers une perception tout à la fois positive et intégrale. Mais elles ne sont pas les gages d’une valeur absolue susceptible de conférer à leurs détenteurs la légitimation d’un statut hégémonique.
Les langues considérées comme les plus grandes au monde à cause de la visibilité qui leur est attribuée par les pays qui les incarnent, n’ont atteint leur niveau de développement actuel que grâce à une volonté politique d’un souverain et la complicité patriotique d’un peuple. (P 71-72)
Collection Écrire l’Afrique
ISBN : 978-2-343-11711-9
20,50 € • 214 pages
Contact promotion et presse
Virginie Robert
5, rue de l’Ecole Polytechnique 75005 Paris
Tél 01 40 46 79 26
virginie.robert@harmattan.fr
www.facebook.com/Editions.Harmattan
@H a r ma t t a n P a r i s
www.youtube.com/user/harmattan