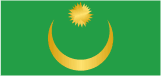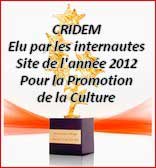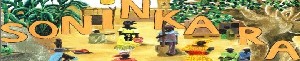01-04-2025 20:16 - SAHEL SOUS TENSIONS | Faillite de l’alliance des Etats du Sahel : un problème pour la France et l’Europe

Atlantico -
Promue comme une ère nouvelle de souveraineté, l’Alliance des États du Sahel s’enlise dans l’insécurité, la répression politique et l’influence croissante de la Russie.
Tandis que le djihadisme progresse et que l’isolement diplomatique s’accentue, certains pays voisins comme le Bénin ou la Mauritanie tracent une autre voie, fondée sur la stabilité, le développement et la coopération régionale.
Un Sahel entre djihadisme et influence russe qui pourrait vite regretter la présence française
Malgré les promesses d’une nouvelle ère de souveraineté, l'Alliance des États du Sahel (AES) peine à endiguer l'avancée des groupes djihadistes. Les attaques se multiplient, la répression s'intensifie et l'influence de la Russie se renforce, accentuant l’isolement de cette alliance.
Face à ce chaos, certains pays de la région, comme le Bénin et la Mauritanie, offrent des exemples de résilience en combinant sécurité renforcée et développement économique. Mais la stabilisation reste la clé pour l'avenir du Sahel.
L'Alliance des États du Sahel (AES), annoncée avec une forte couverture médiatique et créée le 16 septembre 2023 devait ouvrir pour le Sahel une nouvelle ère radieuse de souveraineté retrouvée et de prospérité. Cette nouvelle alliance diplomatique s’inscrit dans le sillon de la vague de putschs militaires successifs qui a touché successivement le Mali, le Burkina Faso et le Niger. A ses débuts, elle promettait des succès militaires rapides, qui, selon la rhétorique populiste enflammée des nouveaux dirigeants, avaient été empêchés par la maléfique présence française dans la région.
Mais l’heure est aujourd’hui à un premier bilan : le compte n’y est pas. Malgré la coopération militaire renforcée, les pays de l'AES n'ont pas réussi à endiguer la progression des groupes djihadistes, loin de là. Au contraire, les « groupes armés terroristes" - ou GAT selon l’acronyme consacré pour désigner les groupes djihadistes qui opèrent dans la région tels qu’Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), qu'le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM) ou encore l'État islamique au Grand Sahara (EIGS) – retrouvent des couleurs. Dans le nord du Mali, la rébellion à dominante touareg, réunie au sein du Cadre Stratégique Permanent (CSP), inflige des revers sérieux, notamment grâce à leurs drones, à la junte malienne et aux mercenaires russes du groupe Wagner, ces derniers étant localisés dans leurs bases de Goundam et de Léré.
De nombreux exemples récents sont venus illustrer cette donne sécuritaire dramatique dans la région. Le 24 août 2024, la commune de Barsalogho a ainsi été le théâtre de l'attaque la plus meurtrière de l'histoire du Burkina Faso. Plus de 300 personnes, principalement des civils, ont été tuées par des djihadistes affiliés au Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM). Le même mois, le Conseil de sécurité des Nations unies a exprimé sa préoccupation face à l'expansion des activités terroristes de Daech et de ses affiliés en Afrique de l'Ouest et au Sahel, s’inquiétant de la capacité de nuisance accrue de ces groupes dans la région en raison du vide sécuritaire laissé par l’armée française. Vide que va renforcer le départ de nos troupes du Tchad, la base aérienne Sergent Adji Kossei à N'Djamena, dernière installation militaire française au Tchad, ayant été transférée aux autorités locales le 31 janvier dernier.
Plus inquiétant encore, ce chaos sécuritaire s’exporte vers le Maghreb, qui constitue pourtant un pôle de relative stabilité dans cet environnement géostratégique. En février dernier, les autorités marocaines ont démantelé une cellule affiliée à l'État islamique, composée de douze individus planifiant des attaques sur le sol marocain. Cette cellule était en lien avec des commanditaires opérant dans le Sahel et en Libye, et prévoyait des attentats à l'explosif dans des lieux publics.
Haro sur les opposants et tapis rouge pour la Russie
Les régimes putschistes sahéliens se trouvent désormais isolés. Les opinions locales, qui ont longtemps suivi leurs dirigeants comme on suit le joueur de flûte de Hamelin, commencent à éprouver des doutes quant au bien-fondé leur action. Les putschistes doivent compenser les promesses non tenues par une surenchère populiste alimentée par une rhétorique d'hostilité à la France. Un exemple parmi tant d’autres : en juin 2024, onze cadres de l'opposition ont été arrêtés à Bamako lors d'une réunion de la plateforme "Déclaration commune du 31 mars", qui milite pour le retour à l'ordre constitutionnel. Accusés « d’opposition à l'exercice de l'autorité légitime », ils ont été transférés dans différentes prisons à travers le pays. Les attaques contre la presse se multiplient. Au Mali encore, les autorités ont coupé en décembre dernier le signal de la chaîne de télévision Joliba TV News après qu'un homme politique a critiqué les dirigeants militaires du Burkina Faso lors d'un débat télévisé.
Cette fuite en avant répressive accroît l’isolement diplomatique des pays membres de l’AES sur la scène internationale. Ceux-ci ont été confrontés à des sanctions et à une marginalisation progressive dans la région, notamment à partir de leur retrait de la Cedeao - Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest, organisation régionale ouest-africaine - acté le 29 janvier 2025. L’ours russe s’engouffre dans la brèche et profite de la fragilité de ce qui s’apparente de plus en plus à un consortium d’Etats faillis. En décembre 2024, au moins six mercenaires russes ont été tués lors d'une embuscade dans la région de Mopti, mettant en lumière l'intensification des opérations militaires russes dans la région. Ce mois-ci, trois journalistes tchadiens ont été arrêtés pour des liens présumés avec le groupe Wagner, accusés de complot contre l'État et d'intelligence avec la Russie.
Une arrestation qui suscite des interrogations quant à la liberté de la presse et l'influence croissante de la Russie au Tchad. Une influence que va probablement renforcer la résiliation du pacte militaire avec la France. Au Niger, des accords de coopération ont été conclus en novembre 2024 entre la Russie et le Niger lors de la visite à Moscou du Premier ministre nigérien, couvrant divers domaines (sécurité et exploitation minière en particulier).
Le même mois, une délégation militaire russe est arrivée dans le pays voisin, à Ouagadougou, renforçant la coopération sécuritaire avec le Burkina Faso. La promesse de souveraineté semble loin : les Etats putschistes sahéliens se voient contraints d’accepter la protection de leurs nouveaux alliés russes, toujours plus encombrants.
A l’ouest de l’Afrique rien de nouveau ?
Ce panorama de la région sahélienne semble désolant et le risque de déstabilisation est avéré, le chaos faisant tache d’huile vers la région du Golfe de Guinée ou vers le Maghreb. Il y a néanmoins quelques pays qui essayent d'éviter d'être contaminés par la fuite en avant sahélienne, notamment en luttant contre le djihadisme et en misant tant que faire se peut sur le développement économique.
Prenons l’exemple du Bénin, petit confetti d’un peu plus de 13 millions d’habitants accolé au géant nigérian, qui développe depuis plusieurs années maintenant une stratégie qui porte ses fruits, alliant mesures sécuritaires et initiatives de développement socio-économique. Cette stratégie, qui marche sur deux jambes, a été mise en place face à l'escalade des menaces terroristes à partir de 2022 et au risque de contagion de la menace sécuritaire venue du Niger. Des bases opérationnelles avancées ont été établies dans le nord du pays, notamment à Batia et Porga, afin de sécuriser les zones vulnérables.
Des formations spécialisées ont également été dispensées aux forces de défense et de sécurité pour améliorer leur efficacité opérationnelle. La population peule - parfois sensible aux sirènes du djihadisme et de l’irrédentisme, en raison d’une identité forte, d’une histoire pluriséculaire et d’une présence à cheval sur l’ensemble des pays de la région – fait l’objet d’efforts spécifiques de la part du gouvernement béninois, notamment en ce qui concerne l’intégration économique des femmes peules, essentielle à une stabilisation globale des régions du Nord.
Les indicateurs économiques béninois sont au vert, preuve que le fatalisme n’est pas de mise au sujet du décollage économique de la région. La croissance pour 2025 est annoncée à 6,4%, l’inflation est contenue à 1,5% et le ratio dette publique / PIB à 52,5% est correct. Il est vrai que le pays bénéficie d’une position stratégique, car il constitue un accès à la mer indispensable pour les pays de l’hinterland, avantage renforcé par l’oléoduc de 2000 km qui le relie au Niger. Mais le Bénin n’est pas une exception : un pays comme la Côte d'Ivoire connaît également une dynamique économique certaine depuis plusieurs années, avec une croissance supérieure à 6% en 2024, soutenue par des secteurs clés comme l'agriculture, l'industrie et les services. Le pays est devenu un leader régional dans la production de cacao et de café, tout en diversifiant ses exportations grâce à la construction de nouvelles infrastructures terrestres et portuaires.
Mais, pour l’ensemble des pays de la région, la stabilisation de la situation sécuritaire est la clé de tous les succès à venir. C’est ce qu’a bien compris un autre pays de la région, la Mauritanie, méconnue en Europe car situés géographiquement entre deux pays mieux identifiés, le Maroc et le Sénégal.
Pourtant, la Mauritanie se distingue aujourd’hui comme une exception sécuritaire dans le paysage sahélien, ayant évité les attaques terroristes sur son sol depuis 2011. Cette stabilité est attribuable à une stratégie de lutte contre le terrorisme combinant des approches sécuritaires et de déradicalisation.
Les autorités mauritaniennes ont également mis en place des mécanismes tels que les processus de Nouakchott et de Djibouti, renforçant la coopération régionale en matière de sécurité et de renseignement pour combattre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Ce risque djihadiste atténué par rapport ses voisins sahéliens se traduit par un soutien financier des partenaires bilatéraux et multilatéraux, et donc une certaine stabilité macroéconomique caractérisée par une croissance de 4,5% en 2024 et annoncée en forte hausse à 6% en 2025 : les dividendes de la paix.
Le devenir de la région sahélienne et de l’Afrique de l’Ouest n’est pas donc pas écrit d’avance, il est avant tout le fruit de décisions politiques. Dans ce paysage, la faillite de l’Alliance des Etats du Sahel, de plus en plus évidente aux yeux des observateurs avertis et des populations locales, apparaît comme un boulet au pied de la région. Il n’est toutefois pas interdit d’espérer face aux réussites d’autres pays, qui ouvrent, parfois sous les radars médiatiques internationaux, un chemin de paix.
Gabriel Robin