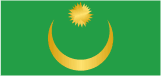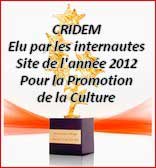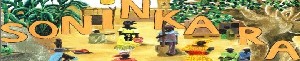10-07-2025 18:35 - Trump, maître d’école face à une Afrique qui baisse les yeux

Le Rénovateur Quotidien -
Il fallait voir la mise en scène pour la croire. Donald Trump, président des États-Unis, accueillait cette semaine cinq chefs d’État africains dans les salons solennels de la Maison-Blanche.
Censée marquer un tournant dans les relations entre les États-Unis et l’Afrique, cette rencontre a davantage évoqué une leçon magistrale qu’un sommet diplomatique.
Le ton était donné : Trump parlait, les présidents africains écoutaient. Le « nouveau paradigme » vanté — moins d’aide, plus de commerce — ressemblait à un vieux schéma colonial : l’Amérique dicte, l’Afrique s’ajuste.
Et dans cette étrange salle de classe improvisée, les chefs d’État ouest-africains semblaient avoir troqué leur souveraineté contre un stylo et un cahier de notes.
Une diplomatie de la docilité
Joseph Boakai (Libéria), Bassirou Diomaye Faye (Sénégal), Umaro Sissoco Embaló (Guinée-Bissau), Mohamed Ould Ghazouani (Mauritanie) et Brice Oligui Nguema (Gabon) se sont pliés à l’exercice avec un mélange d’application et de prudence. Trop de prudence.
L’instant révélateur survient lorsque Trump, surpris par l’anglais fluide du président libérien, s’enquiert de l’origine de cette « belle langue » : « Where did you learn English so beautifully? » Le Libérien répond calmement : « In Liberia. » Cette remarque, digne d’un touriste mal informé, aurait mérité une mise au point cinglante. Elle n’en reçoit aucune. L’on sourit. L’on acquiesce. On attend la suite du cours.
Et la suite, justement, n’est qu’un défilé de postures trop modestes pour être stratégiques. Le président sénégalais Faye vante les mérites de ses terrains de golf pour flatter l’ego de l’ancien magnat de l’immobilier. Embaló reste laconique, conscient peut-être que le silence est plus sûr que la parole. Ghazouani se fait couper la parole par un Trump pressé, sans protestation. Nguema, plus chanceux, repart avec la promesse d’un investissement minier. Prix d’un comportement sans accroc.
Des chefs d’État réduits à des rôles secondaires
Ce mini-sommet avait pourtant été annoncé comme un moment-clé. L’Afrique, nous disait-on, devait prendre place à la table des grandes puissances pour y défendre ses intérêts. Or, à Washington, les intérêts africains se sont dissous dans une logorrhée américaine centrée sur la migration et les ressources naturelles.
Car derrière les sourires, un enjeu majeur se profilait : la question migratoire. Trump veut externaliser la gestion des flux en proposant aux pays invités de devenir des « pays tiers sûrs », c’est-à-dire des zones de transit ou de rétention pour les migrants expulsés. Le Libéria serait en tête de liste. Aucune voix forte ne s’est élevée pour questionner la légitimité d’un tel projet. Où était la défense de la souveraineté africaine ? De la dignité diplomatique ? Du droit de regard sur ce qui touche aux vies humaines ?
L’Afrique peut-elle encore s’asseoir à la bonne table ?
Ce qui frappe dans cette scène, ce n’est pas tant l’attitude de Trump — fidèle à lui-même, directif, souvent mal informé, toujours sûr de son bon droit — que celle des chefs d’État africains, tous visiblement trop soucieux de préserver un accès au « bon élève » du moment, au détriment d’une parole libre et assumée.
Leur discrétion a un coût : l’effacement progressif de l’Afrique sur la scène des grands débats internationaux. Car pendant que Trump leur rappelait, d’un ton professoral, les règles du commerce selon Washington, le reste du monde — Chine, Russie, Union européenne — observe. Et conclut.
Ce que nous dit ce sommet, c’est l’état d’une relation encore déséquilibrée
À défaut d’un dialogue entre partenaires, on assiste à une pièce où le scénario est écrit d’avance : le Nord propose, le Sud dispose. Et lorsque les plus hauts représentants africains acceptent de participer à cette chorégraphie sans mot dire, ils entérinent un modèle dont leur continent devra, tôt ou tard, se libérer.
L’Afrique n’a pas besoin d’un maître, ni de conseils condescendants. Elle a besoin d’un espace de négociation équitable, fondé sur la réciprocité, la dignité et la connaissance mutuelle. Ce que la Maison-Blanche n’a manifestement pas offert cette semaine.