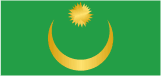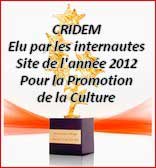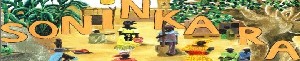20-06-2025 12:33 - Israël-Iran : Genève, dernière chance avant l’embrasement ?

Par Cheikh Sidati Hamadi,
Chercheur associé, Analyste, Expert Senior en Droits Humains
Le Proche-Orient est, une nouvelle fois, suspendu à un équilibre fragile. Alors que la tension militaire entre Israël et l’Iran atteint un niveau rarement observé depuis quatre décennies, l’attention internationale se concentre sur Genève, où une rencontre déterminante entre diplomates européens et iraniens est prévue ce 20 juin.
Initialement convoquée pour tenter de relancer un accord sur le nucléaire iranien (JCPOA), cette réunion a vu son importance croître à mesure que le contexte sécuritaire s’est dégradé.
Cette détérioration s’est accélérée avec les frappes iraniennes ayant touché un hôpital israélien, faisant plusieurs dizaines de blessés, et par une déclaration remarquée du ministre israélien de la Défense, évoquant ouvertement la possibilité d’éliminer Ali Khamenei, Guide suprême de la République islamique d’Iran. Cette déclaration marque un seuil rhétorique inédit dans l’histoire des relations entre les deux États.
Ce qui relevait jusqu’ici d’une guerre par procuration glisse progressivement vers une confrontation assumée entre États.
Un antagonisme ancien, structurel et relancé
Depuis 1979, Israël considère l’Iran comme une menace stratégique. Cette perception s’est renforcée par le soutien constant de Téhéran à divers mouvements hostiles à l’État hébreu, en particulier le Hezbollah libanais. Israël a progressivement mis en œuvre une stratégie de frappes préventives fondée sur la doctrine Begin : frapper avant que la menace ne devienne directe.
De son côté, l’Iran a bâti un réseau régional complexe reposant sur des alliances militaires et idéologiques solides, afin de garantir une « profondeur stratégique » en cas d’agression. Le Hezbollah, les milices chiites irakiennes, ou encore les Houthis au Yémen constituent autant de leviers militaires disséminés dans la région. Cette stratégie asymétrique, longtemps efficace pour dissuader des agressions extérieures, semble aujourd’hui atteindre ses limites.
Un engrenage alimenté par les vulnérabilités internes
Cette escalade s’appuie également sur des contextes internes fragiles de part et d’autre. En Israël, une coalition politique dominée par des partis nationalistes poursuit une ligne dure à des fins internes de cohésion politique. En Iran, une économie sous sanctions, marquée par une inflation élevée et une défiance sociale croissante, pousse le régime à réaffirmer son autorité à travers ses bras militaires régionaux.
Cette dynamique, où les faiblesses internes se transforment en moteur d’escalade, est un classique des situations pré-guerre. Plus que la volonté de guerre, c’est souvent l’absence de solutions politiques internes qui alimente l’impasse diplomatique.
Genève : entre nécessité diplomatique et calculs stratégiques
Dans ce contexte, la rencontre de Genève ne porte plus uniquement sur les questions nucléaires, mais s’impose désormais comme une tentative de désescalade globale. Pour l’Union européenne, dont la capacité d’influence a été réduite par les crises successives, ce sommet représente un test majeur de pertinence diplomatique. La France joue ici un rôle moteur, consciente que le multilatéralisme est le dernier recours avant la confrontation.
Du côté iranien, l’objectif est clair : arriver à la table des négociations après avoir démontré une capacité à perturber l’ordre régional, afin d’obtenir un allègement ciblé des sanctions. Toutefois, ni les Européens ni l’Iran ne peuvent, à eux seuls, inverser la dynamique d’escalade. Le rôle déterminant incombera aux États-Unis et à la Chine, seuls capables de créer un rapport de forces diplomatique suffisant pour peser sur les décisions finales.
Trois trajectoires possibles
À court terme, trois scénarios sont envisageables :
1. Échec complet. escalade généralisée : des frappes ciblées d’Israël contre des responsables iraniens pourraient entraîner une riposte régionale coordonnée. Le Liban serait vraisemblablement le premier théâtre de confrontation.
Cependant, cette hypothèse mérite nuance. Le Hezbollah, malgré ses capacités militaires, opère dans un Liban en crise profonde, économiquement asphyxié et politiquement fracturé. Une partie de sa base sociale, affectée par des années de conflit et d’effondrement économique, pourrait ne pas soutenir une ouverture immédiate d’un front majeur. Cela explique sans doute la posture prudente, voire ambiguë, observée ces derniers mois.
2. Trêve temporaire . statu quo fragile : scénario probable, permettant aux acteurs d’éviter une confrontation directe tout en maintenant une guerre indirecte par proxys.
3. Accord partiel . désescalade progressive : envisageable si Washington et Pékin exercent conjointement une pression diplomatique déterminante, ce qui reste incertain dans le contexte international actuel.
Le scénario extrême : l’élimination de Khamenei, point de rupture stratégique
Parmi les hypothèses les plus préoccupantes figure celle de l’élimination physique d’Ali Khamenei. Bien qu’encore hypothétique, une telle opération constituerait une rupture stratégique majeure, aux conséquences incalculables.
En cas d’attaque ciblée contre le Guide suprême, l’Iran mobiliserait immédiatement l’ensemble de ses relais militaires régionaux. Une guerre ouverte au Liban deviendrait hautement probable. La fermeture du détroit d’Ormuz entraînerait un choc économique mondial immédiat.
Paradoxalement, loin de fragiliser le régime iranien, un tel événement pourrait ressouder durablement une partie de la société iranienne autour d’une figure martyrisée, renforçant temporairement la cohésion nationale.
Enfin, une telle action poserait un problème juridique majeur : elle constituerait une violation manifeste de l’article 2 de la Charte des Nations unies interdisant le recours à la force contre l’intégrité ou l’indépendance politique d’un État membre.
Les États-Unis : tentation des frappes sur les sites nucléaires
Un autre facteur de basculement réside dans la tentation américaine de frapper directement les infrastructures nucléaires iraniennes si une confrontation militaire ouverte éclatait. Cette hypothèse, étudiée depuis des années par le Pentagone, reviendrait à engager formellement Washington dans le conflit.
Militairement, les États-Unis disposent des moyens techniques pour mener des frappes ciblées sur les installations principales, notamment à Natanz, Fordo ou Arak. Mais cette option soulèverait des conséquences immédiates :
Sur le plan régional, l’engagement américain serait perçu par l’ensemble du monde chiite comme un acte de guerre totale contre l’Iran.
Sur le plan mondial, cela provoquerait une division marquée au sein du Conseil de sécurité de l’ONU, Moscou et Pékin rejetant toute légitimité à une telle opération.
Sur le plan énergétique, une attaque contre les infrastructures nucléaires irait de pair avec des fermetures ciblées de routes pétrolières par l’Iran, exacerbant encore la volatilité économique mondiale.
Enfin, sur le plan intérieur américain, une telle décision exposerait l’administration de Washington à une polarisation politique accrue en période préélectorale.
Si l’hypothèse reste marginale à ce stade, elle ne peut plus être totalement écartée dans un contexte de surenchère militaire croissante.
Un vide structurel dans la sécurité régionale
Au-delà de cette séquence immédiate, cette crise met en évidence un vide durable : l’absence d’un véritable mécanisme régional de sécurité collective au Moyen-Orient. Tant que cette architecture n’existera pas, les crises continueront à émerger par cycles, selon les circonstances locales et les fluctuations des équilibres globaux.
Conclusion : Genève, entre désescalade fragile et précipice
La rencontre de Genève représente un moment charnière. Si elle échoue, les heures qui suivront pourraient entraîner une accélération des tensions et un risque de confrontation généralisée.
Cette situation pose, une fois de plus, la question récurrente de l’efficacité des dispositifs internationaux face à des logiques de guerre structurelles. Seul un choix politique délibéré, au-delà des intérêts immédiats, permettra d’inverser la trajectoire.
Cheikh Sidati Hamadi
Chercheur associé, Analyste, Expert Senior en droits humains
Références
1. Mediapart – Israël menace Khamenei : https://www.mediapart.fr
2. AFP – Frappes iraniennes : https://www.afp.com/fr/actualites/israel-iran-frappes
3. IDF Archives – Doctrine Begin : https://www.idf.il/en/mini-sites/history/the-begin-doctrine/
4. International Crisis Group, Rapport n°237 (avril 2025) : https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa
5. Reuters – Analyse Israël (15 juin 2025) : https://www.reuters.com/world/middle-east
6. Banque mondiale – Iran Economic Update (mai 2025) : https://www.worldbank.org/en/country/iran/publication/economic-update-may-2025
7. Ministère français des Affaires étrangères – Genève (19 juin 2025) : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/iran/evenements/
8. ECFR – Iran Nuclear Deal (juin 2025) : https://ecfr.eu/publication/the-eu-and-the-iran-nuclear-deal/
9. CFR – Strategic Priorities 2025 : https://www.cfr.org/report/strategic-priorities-2025
10. Middle East Institute – China’s Role (juin 2025) : https://www.mei.edu/publications/chinas-role-middle-east-stability