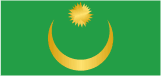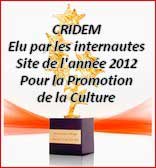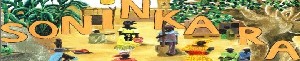14-09-2025 13:37 - Mauritanie : le piège malien. Par Pr ELY Mustapha

La crise malienne tend à externaliser vers ses voisins le coût sécuritaire, politique et humanitaire de l’escalade, exposant la Mauritanie à une aspiration dans le conflit si la neutralité active n’est pas maintenue avec rigueur. L’option gagnante est de refuser la cobelligérance, verrouiller les marges frontalières, soutenir l’effort humanitaire et piloter une diplomatie de désescalade tout en sécurisant les corridors Kayes–Nioro et Nouakchott–Bamako.
Le « piège » est véritablement naît de la fin de l’Accord d’Alger, de l’intensification des attaques jihadistes à l’ouest malien et du débordement humanitaire vers Mbera et les villages hôtes du Hodh Chargui, créant un gradient d’escalade qui pousse les voisins à s’impliquer au-delà de leur intérêt national.
La polarisation via la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES) accroît les pressions d’alignement dans un environnement institutionnel fragmenté, ce qui réduit la marge de manœuvre des États non membres comme la Mauritanie.
Avant d'exposer l'approche empirique pour faire face au piège malien qui se dessine, deux approches doctrinales permettent de placer avec profit, le décor conceptuel de notre analyse.
L'approche d’« omnibalancing » explique que les petites puissances arbitrent simultanément menaces externes et pressions internes, la stabilité domestique guidant l’alignement plus que la seule menace extérieure, d’où l’intérêt d’une neutralité active qui minimise l’exposition interne.
L'approche dite « hedging » permet d’éviter l’alignement binaire en combinant engagements ciblés, déni de domination et pragmatisme coopératif, ce qui convient aux environnements sahéliens fluides et polarisés.
La dissuasion par déni, plus vigoureuse sous les seuils de guerre ouverte que la punition, oriente vers ISR (renseignement, surveillance, reconnaissance pour la décision et l’action), anti drones, barrières intelligentes et escortes de convois côté mauritanien, plutôt que compellence transfrontalière risquée.
En effet, la compellence est une stratégie politico-militaire qui vise à forcer un adversaire à changer de comportement en utilisant la menace ou l'usage limité de la force pour obtenir une action spécifique de sa part. Contrairement à la dissuasion qui cherche à empêcher un adversaire d'agir, la compellence cherche à le faire agir pour modifier le statu quo.
Cette stratégie, développée par Thomas Schelling, peut impliquer des punitions ou la négation des objectifs de l'adversaire, et est considérée comme plus difficile à mettre en œuvre que la dissuasion.
La « zone grise » implique des réponses modulaires, multi-domaines et étagées dans le temps pour neutraliser les faits accomplis sans sur réagir, ce que recommande la littérature stratégique récente. En effet, l’approche indirecte à la Liddell Hart privilégie la dislocation logistique et psychologique de l’adversaire par économie de force, ce qui, pour une petite puissance, se traduit par la protection des centres de gravité nationaux et la résilience des corridors plutôt que par des poursuites offensives.
La mécanique du piège malien: extériorisation frontalière de la violence
La cessation unilatérale de l’Accord d’Alger par Bamako a fermé des canaux de dialogue politique avec les groupes du Nord, rigidifiant l’option militaire et réduisant les issues de désescalade. Ce basculement a accru les flux de risques aux frontières, en multipliant les déversements sécuritaires vers les pays voisins.
L’intensification des violences au Mali a gonflé les arrivées au camp de Mbera et dans les villages hôtes du Hodh, saturant progressivement services et ressources locales déjà contraintes. Ce débordement humanitaire devient un multiplicateur de vulnérabilités si la réponse demeure sous dimensionnée et non territorialisée.
En juillet 2025, JNIM a orchestré des attaques coordonnées, assorties de menaces de blocus sur Kayes et Nioro, visant à perturber les flux logistiques régionaux. Cette pression cherche à exporter le coût de la guerre vers les voisins en les contraignant à s’impliquer sécuritairement au-delà de leur intérêt national.
La Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES) reconfigure les alignements et durcit la rhétorique d’adhésion sécuritaire, ce qui réduit la flexibilité stratégique des États non membres. Cette polarisation complique la coopération souple et les mécanismes informels de désescalade transfrontalière.
Le bras de fer avec Alger autour de l’Accord d’Alger illustre une projection de responsabilités vers l’extérieur, créant un climat d’accusations réciproques susceptible d’essaimer à d’autres voisinages. Cette dynamique érode la confiance régionale et rend plus coûteuses les initiatives de sécurité coopérative.
Les blocages ciblés et les kidnappings perturbent les chaînes d’approvisionnement, accroissent les primes de risque et poussent les États riverains à des réponses plus intrusives qui alimentent la spirale d’escalade. Les corridors et marchés frontaliers deviennent des centres de gravité contestés où chaque incident peut déclencher une surréaction.
Pourquoi résister …et ce qu'il ne faut pas faire
Entrer en cobelligérance exposerait à des représailles asymétriques tout en diluant l’efficacité de la coopération frontalière calibrée recommandée pour Kayes-Nioro. Le rapport coût-effet d’une posture offensive hors territoire deviendrait défavorable pour une petite puissance, avec un contrôle de l’escalade incertain.
L’afflux actuel éprouve déjà le camp de Mbera et les communautés hôtes, et une militarisation accrue ferait exploser les besoins de protection, d’eau, de santé et d’abris. Le coût social et politique en interne s’en trouverait amplifié, nourrissant les griefs exploitables par des acteurs armés.
Un faux pas sécuritaire accélérerait des blocus localisés, perturberait l’axe Nouakchott-Bamako et transmettrait des chocs de prix et d’emploi à l’économie domestique. La résilience des chaînes logistiques dépend d’une sécurité de proximité et de la redondance plutôt que de ripostes extraterritoriales.
Préserver une neutralité active maintient la capacité de médiation et la flexibilité diplomatique dans un paysage institutionnel sahélien fragmenté. Cette marge permet d’ancrer des coalitions ad hoc de renseignement et d’humanitaire sans s’aligner idéologiquement.
Comment agir sans cobelligérance
La sécurisation doit rester strictement territorialisée: patrouilles conjointes côté mauritanien, partage de renseignement, moyens ISR et anti drones à la frontière, sans franchissement de la ligne internationale. Cette approche renforce le déni d’accès et la réactivité.
La protection des corridors impose des escortes, des hubs logistiques côté mauritanien, des plans de contingence carburant et une redondance d’itinéraires et de stocks pour amortir toute tentative de blocus. L’objectif est de rendre inopérants les effets de levier économiques recherchés par les acteurs armés.
La résilience civile requiert un soutien hors-camp et le renforcement des services à Mbera et dans les villages hôtes afin d’absorber l’afflux sans tensions communautaires. Investir dans l’accès à l’eau, la santé et la protection diminue la surface de vulnérabilité exploitable.
La prévention de l’embrasement local passe par des médiations foncières et agro pastorales au niveau des marges, pour tarir les conflits instrumentalisés dans les recrutements armés. Stabiliser les arrangements de mobilité et de pâturage réduit les frictions récurrentes en saison critique.
La diplomatie de désescalade doit relancer le processus de Nouakchott pour l’échange de renseignements et la coordination sécuritaire, tout en gardant ouverts les canaux avec les partenaires régionaux et multilatéraux. Cette plateforme offre un format puissant pour coopérer sans s’enfermer dans un alignement de bloc.
La maîtrise juridique des flux implique d’éviter les refoulements à risque et d’articuler toute mesure d’éloignement avec des garanties de protection pour ne pas nourrir de cycles de représailles. Le respect des normes renforce l’acceptabilité et coupe court aux attitudes de victimisation.
Le déroulé stratégique doit insister sur la neutralité active, la protection des civils et la sécurisation des flux, en refusant les binarités d’alignement qui alimentent la polarisation. Une communication factuelle et mesurée soutient la dissuasion par crédibilité et cohérence.
Lignes rouges à ne pas franchir, pour ne pas justifier l'injustifiable
Aucune entrée en territoire malien hors cadre multilatéral strictement limité à la protection des civils, afin d’éviter la logique d’attrition recherchée par les acteurs du conflit. Cette retenue protège la liberté d’action et la légitimité de la posture défensive.
La priorité va à la dissuasion de déni: défense des axes, dépôts et points sensibles, appuyée par des moyens anti drones, des capteurs et une allocation ISR forte. Rendre l’agression coûteuse et incertaine suffit souvent à annuler l’avantage attendu par l’adversaire.
Zéro exaction et zéro refoulement à risque sur la bande frontalière, pour couper court aux propagandes et empêcher les cycles de représailles dans le triangle Kayes–Nioro–Hodh. L’exemplarité juridique et opérationnelle est un multiplicateur de sécurité en zone grise.
Scénarios et parades à envisager
Si JNIM tente un blocus, activer immédiatement un mode « sécurisation de corridor » côté mauritanien avec convois escortés, hubs, relais portuaire et partage de renseignement tripartite, sans franchir la frontière. La robustesse logistique et l’alerte précoce réduisent l’attractivité du blocus comme instrument de coercition.
Si Bamako accentue la pression politique, réaffirmer la neutralité active, renvoyer aux cadres régionaux de coopération et conditionner toute initiative à la protection des civils et à la non extension du conflit. La cohérence procédurale protège de l’enfermement dans un face à face bilatéral escalatoire.
Si l’afflux s’accélère, déclencher un surge humanitaire hors camp et des programmes rapides de stabilisation communautaire dans le Hodh, afin de préserver l’acceptabilité sociale. Le surge étant la capacité à mobiliser et à déployer rapidement des ressources financières, humaines et matérielles supplémentaires pour répondre aux besoins lorsque les capacités d'intervention existantes sont insuffisantes. Enfin, anticiper des pics d’arrivées limite l’érosion des capacités et la diffusion des tensions.
Ainsi la combinaison omnibalancing hedging, appliquée à ce qui se présente comme un véritable piège, justifie une neutralité engagée mais non alignée, calibrée pour réduire l’exposition intérieure tout en coopérant sur la sécurité de frontière et l’humanitaire. La dissuasion par déni et l’approche indirecte orientent l’investissement vers l’ISR, les moyens anti drones, le durcissement des cibles et la fiabilité logistique, plutôt que la compellence transfrontalière à haut risque.
La gestion de la zone grise privilégie des réponses graduées, multi domaines et réversibles qui neutralisent les faits accomplis sans escalade, consolidant la cohérence de la posture mauritanienne sur le théâtre sahélien….sans réveiller les démons d'une guerre que ceux qui l'ont chez-eux, voudraient y induire ceux qui n'y sont pas..
Comme l'aurait dit un diplomate français bien averti : " le terrorisme nous tend un piège. Il veut nous pousser à la faute, et la faute, c’est la guerre.”
Pr ELY Mustapha