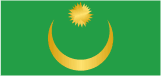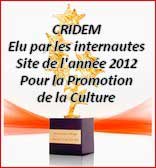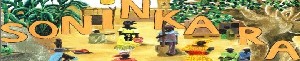13-02-2014 22:42 - Science et autorité
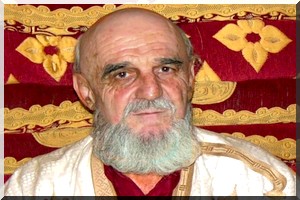
Le Calame - Beaucoup croient qu’il existe une différence d’approche, fondamentale et irréductible, dans le rapport à la science et l’autorité, entre les discours occidental et musulman. Or toute une lignée de savants démontre le contraire.
Ecoutons, à titre d’exemple, le célèbre philosophe Pascal, dans sa « Préface au Traité du vide » (1651), clé essentielle pour la compréhension de son œuvre : « tout ce qui est l’objet de la foi ne saurait l’être de la raison et beaucoup moins y être soumis ». De ce principe, il a distingué deux sortes de sciences...
Les unes dépendent de la raison ou de l’expérience, mise en forme par le raisonnement : ce sont, nous dit Pascal, « la géométrie, la musique, la physique, la médecine ». Elles peuvent être indéfiniment augmentées ; chaque proposition que la raison établit en engendre d’autres, si bien que la géométrie, par exemple, « a une infinité d’infinités de propositions à exposer ».
Dans ces sciences seules, existe un « progrès des Lumières » : elles « doivent être augmentées pour devenir parfaites […] les Anciens les ont trouvées seulement ébauchées par ceux qui les ont précédés », et « nous les laisserons, à ceux qui viendront après nous, en un état plus accompli que nous ne les avons reçues ».
Ainsi « tous les hommes ensemble y font un continuel progrès, à mesure que l’univers vieillit », comme si l’humanité était « un même homme qui subsiste toujours et qui apprend continuellement ». Dans ces sciences, l’autorité n’a aucun poids : « si je conçois clairement un théorème de mathématiques, le plus puissant roi du Monde ne saurait m’imposer de croire le contraire ».
La théologie, une affaire d’autorité
Les sciences qui dépendent de la mémoire sont d’une autre nature : les références sacrées, l’histoire, la géographie, la jurisprudence ne sont connues que par les livres qui en traitent et le témoignage de ceux qui ont été au contact direct des faits : « S’il s’agit de savoir qui fut premier roi des Français, en quel lieu les géographes placent le premier méridien [...], quels autres moyens que les livres pourraient nous y conduire ? »
Dans ces sciences, la parole de l’auctor prend toute sa force : sauf évidence contraire, il faut croire l’autorité. Par suite, ces sciences ne peuvent être augmentées, puisqu’elles consistent seulement à connaître ce que les Anciens ont écrit.
La théologie est, fondamentalement, affaire d’autorité : par nature, Dieu dépasse la connaissance des hommes, Il n’est connu qu’autant qu’Il s’est révélé dans l’Ecriture : toute la théologie est, donc, contenue dans les Textes sacrés et dans la Tradition ; elle ne peut être augmentée comme la géométrie ; la connaissance des dogmes peut être éclaircie par la méditation de la Révélation, non pas augmentée par l’invention de dogmes nouveaux. La nouveauté, en théologie, est toujours suspecte : c’est, le plus souvent, la marque de l’hérésie.
Ces sciences diffèrent, donc, en ce que, dans les matières historiques et révélées, il est interdit de contredire l’autorité, alors que dans les sciences de raisonnement, le refus de se soumettre, aveuglément, aux opinions des Anciens est une manière de leur être fidèle : puisqu’ils n’ont pas adopté les idées de leurs prédécesseurs, nous n’avons aucune raison de les copier servilement. « Nous pouvons assurer le contraire de ce qu’ils disaient » sans pour autant les contredire.
En revanche, c’est une tyrannie d’imposer l’autorité dans les sciences de raison : l’Eglise n’avait pas le droit de condamner la cosmologie de Galilée, au nom de la théologie ; ce n’est pas cela qui empêchera la Terre de tourner. De même, on ne peut interdire la théorie physique du vide, sous le prétexte qu’elle contredit l’enseignement d’Aristote.
Mais il y a aussi tyrannie à faire intervenir la raison là où l’autorité est maîtresse : dans la religion chrétienne comme dans la musulmane, « il suffit, pour donner la certitude entière des matières les plus incompréhensibles à la raison, de les faire voir dans les Livres sacrés », la raison doit se soumettre à ces principes et ne peut s’exercer que dans le cadre qu’ils déterminent. Elle peut réfléchir sur les données de l’autorité, les comparer, peser les témoignages mais jamais n’engendrer des faits nouveaux.
En théologie, une fois les dogmes admis, la raison ne peut qu’en tirer les conséquences qui s’imposent. Mais en dernière instance, c’est toujours la raison qui tranche, dans les matières « scientifiques », et la mémoire, dans les matières « historiques » et « révélées ».
Discussion de l’indiscutable
Pascal n’a pas inventé cette distinction des sciences de raison et de mémoire, qui cristallise les idées modernes de son temps. On la trouve chez Descartes ; la Préface s’inspire aussi de Bacon. Mais si Descartes ne fait pas grand cas des sciences historiques, Pascal accorde une part beaucoup plus équilibrée à ces deux genres de connaissance. Sommes-nous, musulmans, si éloignés de cette vision ?
Certes, il y aurait encore à dire, sur la nécessaire quête de la véracité des sources historiques, voire prétendument révélées. On sait, par exemple, avec quelle prudence faut-il aborder la lecture des évangiles chrétiennes. De même, on peut être amené à se poser des questions sur certaines déformations, à visées clairement politiques, dans la mémorisation de certains faits – l’exemple, récent, de la Shoah en est une éloquente – et sur les manœuvres visant à protéger, non plus spécifiquement la mémoire, mais ces déformations mêmes.
On doit, donc, concevoir qu’il existe une frange de discussion de l’indiscutable, tout comme une autre d’indiscussion du discutable. Mais, quelle qu’elle soit et quelque précise qu’elle puisse être, toute science n’a qu’une valeur limitée. Pascal récuse l’idéal cartésien de la mathesis universalis : par nature, le savoir humain est inachevé et local.
La géométrie, par exemple, est infinie en aval, puisqu’elle a « une infinité d’infinités de propositions à exposer » ; elle l’est, aussi, en amont car les principes que nous considérons comme premiers ne le sont jamais absolument : les axiomes auxquels on convient de s’arrêter, en dernière analyse, ne sont derniers que par rapport à la faiblesse de l’esprit humain ; en réalité, ils « ne se soutiennent pas d’eux-mêmes », mais « sont appuyés sur d’autres » que nous n’apercevons pas, « qui, en ayant d’autres pour appui, ne souffrent jamais de dernier ».
En tout cas, chaque connaissance en présuppose d’autres, sans qu’on puisse jamais parvenir à tout savoir : pour « connaître » l’homme, par exemple, il faut savoir ce que sont le lieu et le temps qu’il occupe, les éléments qui le composent, la chaleur et les aliments, l’air, savoir pourquoi il a besoin de respirer et de manger, et ainsi de suite.
L’insuffisance de la science paraît aussi lorsqu’on envisage les rapports humains. Dans sa correspondance de 1654 avec Fermat, Pascal a fait l’expérience d’une collaboration scientifique avec un honnête homme ; mais il avoue, dans les « Pensées », que le peu de « communication » qu’on trouve dans les sciences abstraites l’en a dégoûté : elles ne sont pas « propres à l’homme » et détournent, même et souvent, de la connaissance de soi.
En 1660, Pascal écrit au même Fermat : « Pour vous parler franchement de la géométrie, je la trouve le plus haut exercice de l’esprit ; mais, en même temps, je la connais pour si inutile que je fais peu de différence entre un homme qui n’est que géomètre et un habile artisan. » Pascal l’appelle « le plus beau métier du monde ; mais, enfin, ce n’est qu’un métier, […] elle est bonne pour faire l’essai mais non l’emploi de notre force ». Celui qui fait, de la science, son unique préoccupation en fait un divertissement qui le détourne de la vérité dernière.
« Allahou ‘alim », disons-nous. Mais tous nos ulémas sont-ils bien conscients de ce que cette vérité les oblige, dans leurs jugements et leurs fatwas ? On oublie trop souvent de se taire et de poser, simplement, le front par terre. N’est-il pas remarquable d’y être rappelé par un savant non-musulman ?
Tawfiq Mansour