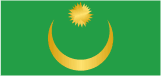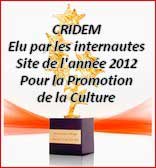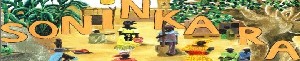02-01-2016 07:45 - Dr Mariella Villasante : L’histoire politique de la confédération des Ahl Sidi Mahmud Assaba, Mauritanie(Suite et fin)

Adrar-Info - Les ASM dans le cadre de l’État mauritanien
• L’installation de l’État mauritanien, présidé par Mukhtar Ould Daddah, ne changea pas fondamentalement les structures sociales et politiques antérieures, du moins pendant une dizaine d’années.
Le grand bouleversement du monde social mauritanien eut lieu lorsque la grande sécheresse s’installe dans le pays, comme partout dans la bande saharo-sahélienne, au début des années 1970.
• La période contemporaine peut être divisée en trois grandes périodes, celle du régime de Mukhtar Ould Daddah, celle du régime de Maouya Ould Sid’Ahmed Taya, et enfin celle qui l’a succédé après son départ en 2005.
(1) Première période : le régime de Ould Daddah
• Mukhtar Ould Daddah ne voulait pas changer le mode de vie des Mauritaniens, jugeant que la démocratie était trop moderne pour ses concitoyens. La sécheresse d’abord, puis la guerre au Sahara occidental, transformèrent ces manières de voir, mais de manière générale, son régime fut marqué par une certaine continuité post-coloniale (Villasante 2002b).
• Mukhtar Ould Daddah décida, lors du premier congrès du Parti du peuple mauritanien de 1963, la suppression des chefferies traditionnelles ; les « chefs de tribus » ne pourraient plus être élus désormais, mais ils conservaient leurs postes et leurs rémunérations.
Les graves questions sociales des hiérarchies statutaires, de l’esclavage interne et des clivages ethniques persistants ne furent pas évoquées par le nouveau régime républicain mauritanien. Pire encore, on imposa l’arabisation dans l’enseignement, alors que toute l’élite était francophone, et que les communautés noires mauritaniennes rejetaient l’arabe.
Ce choix politique aura de conséquences graves et ses effets se font sentir jusqu’à présent, où la polarisation économique exprime la polarisation culturelle (identique dans le Maghreb) entre les élites francophones, et le peuple mauritanien pauvre, qui reçoit une mauvaise éducation en arabe et reste simplement hassanophone et ignorant.
• Pendant et après le mandat de Mukhtar Ould Daddah, on menait un double discours et une double pratique. Les « tribus » et les « ethnies » étaient critiquées comme des obstacles à la construction de l’État et de la nation, mais dans la réalité concrète elles étaient conservées par le biais du respect du régime vis-à-vis les notables traditionnels qui géraient quotidiennement la vie sociale et les conflits sociaux.
Pour cette raison, l’une de mes contributions aux études anthropologiques de la Mauritanie a été de remarquer l’imbrication étroite entre l’ordre de la parenté et l’ordre du politique moderne, autrement dit, la coexistence des organisations politiques traditionnelles avec l’État.
Du point de vue identitaire, les solidarités restreintes, ethniques et de parenté, coexistent avec des solidarités régionales et avec la solidarité nationale en voie de construction. Je peux témoigner qu’en trente ans de recherches, il y a plus de nation dans le pays qu’en 1986, mais que beaucoup d’efforts restent à faire pour que cette construction se fasse dans le cadre des valeurs républicaines d’égalité, de liberté et de justice.
• Aujourd’hui, en 2015, ces questions restent de toute actualité dans le pays car, pour de raisons complexes, les régimes politiques ont continué à mener le double discours de condamnation du monde « traditionnel », au nom de la « modernité », tout en se servant des structures et des organisations traditionnelles pour gouverner et surtout pour maintenir la paix sociale.
• Il est évident qu’après 1960, la société mauritanienne s’est transformée, une nouvelle couche de fonctionnaires et des élites enrichies s’est affirmée, les tensions ethniques et la polarisation des nationalistes arabes et noirs, ainsi que le racisme d’État contre les Noirs mauritaniens ont débouchée sur les terribles violences des années 1989-1992.
Les règlements proposés par le premier régime civil de Sidi Ould Cheikh Abdellahi ont été importants dans l’esprit, mais très éloignés de la justice exigée par les proches des victimes et par les milliers de déportés au Sénégal et au Mali. Comme on le sait, l’autoritarisme étatique est revenu en force après et se poursuit de nos jours.
D’autre part, depuis 1991 des partis politiques ont émergé et des associations des victimes se sont créées. Cependant, les référents identitaires centrés autour des relations de parenté continuent à se reproduire, et l’ordre politique reste organisé dans le cadre des cercles clientélaires et des notabilités appartenant à toutes les communautés ethniques mauritaniennes.
— La chefferie de Muhammad Radhy Ould Muhammad Mahmud (m. 1992)
• Muhammad Radhy Ould Muhammad Mahmud continua sa gestion des affaires de la confédération des ASM jusqu’à son décès, en 1992. Il fut reconnu chef général des ASM par le général de Gaulle, qui lui conféra la médaille de Chevalier de l’ordre du Nichan el-Anouar le 25 juillet 1958 ; et par le président Daddah qui lui conféra l’Ordre du mérite national le 28 novembre 1969.
• Comme d’autres chefs traditionnels, Muhammad Radhy recevait une rémunération annuelle du gouvernement en sa double condition de chef d’une collectivité « tribale » et membre du PPM. Les groupes dont la chefferie était des Idawalhajj (Ahl Khama Khattar, Ahl Muhammad Radhy, Hellet Ahmed Taleb), furent directement concernés par ces liens nouveaux avec l’État, alors que la majorité de la confédération continua son mode de vie centré autour des activités agricoles, pastorales et de commerce.
• Il faut noter que la possibilité d’accéder aux rémunérations étatiques causa des luttes internes dans certains groupes de parenté bidân affaiblis qui ne purent pas conserver leurs liens après la sécheresse. Des « intellectuels » [c’est-à-dire des francophones] ont profité aussi la possibilité de devenir des « cadres du régime » au sein du PPM. Dans les deux cas, l’enjeu n’était pas lié aux populations, mais à l’argent attendu de l’administration moderne.
• Chez les ASM majoritairement installés dans l’Assaba rurale, dans la Rgayba, l’ordre coutumier perdura aussi dans le domaine du foncier jusqu’en 1977, année où le premier conflit de terres fut porté aux autorités régionales de Kiffa.
Les modifications segmentaires et factionnelles ne furent pas importantes durant cette période, s’il y eut des divisions et des nouvelles adhésions (Swaker, Zbeyrat, Ahl Khama Khattar), toujours en relation avec le nouveau pouvoir étatique, aucun groupe ne remit en question son rattachement à la confédération. Notons aussi que pendant quelques années, Muhammad Radhy dû affronter la dissidence de l’un de ses frères, qui contestait son autorité confédérale, mais le conflit se régla à l’amiable.
Groupes rattachés aux ahl sidi mahmûd [1907-1987],
selon les villages recensés en 1987 [RIM-ONS 1991]
___________________________________________________________________
Groupes villageois % total
____________________________________________________________________
ASM Nord [48 villages] 9 615 39
Ahl Muhammad mahmud [Rgayba, tente de chefferie] : 6 599 26,8
ahl Muhammad Radhy [Rgayba] 2 348 12,8
ASM EST [15 villages] 3 147 12,8
Hellet ahmed taleb [Est] 1 775 7,3
Swaker [Est] 1 372 5,5
ASM Sud [45 villages] 11 898 48,2
Ahl Khama khattar [Sud] 4 962 20
zbeyrat kankossa 2 448 10
zbeyrat sélibaby 844 3,4
azeyzat 746 3
ahl hmaymid 1 201 5
tajunit 819 3
Lemjajta 878 3,5
_______________________________________________________________
Total 24 660 100%
____________________________________________________________________
[Villasante 1998 : 154. Les données ne sont pas exhaustives, manquent les citadins de Kiffa et de Nouakchott]
J’ai estimé que la population totale de membres de la confédération était proche de 50 000 membres en 1995 ; depuis lors elle a du augmenter considérablement.
(2) Seconde période : les gouvernements autoritaires
• Comme nous savons, la guerre du Sahara fut le détonateur de la chute du président Daddah et du coup d’État des colonels le 10 juillet 1978. Depuis cette période, l’État mauritanien reste fortement influencé par les forces armées, ce malgré l’installation d’un système de démocratie formelle.
• Dans cette nouvelle période historique, on a connu des grandes transformations dans le pays et dans les référents identitaires. Ces transformations étaient en partie influencées par le nouveau régime militaire, mais surtout par les effets néfastes de la grande sécheresse qui a forcé à la majorité de la population nomade à se sédentariser.
Ce processus a produit des désordres sociaux de taille, tous liés au manque d’organisation gouvernementale, plutôt occupée à mener une guerre au Sahara qu’à secourir les populations mauritaniennes.
Les pressions sociales sur la vallée du fleuve Sénégal, ainsi que le désordre étatique, le racisme d’État, et le manque d’une politique d’intégration nationale, ont provoqué des tensions qui ont débouché sur la grande violence sociale qui a éclaté en 1989 et dont les séquelles sont toujours d’actualité.
• Les grands changements politiques interviennent en 1986, lorsque le gouvernement de Taya décide d’organiser les premières élections municipales au pays. Pendant cette période, entre 1978 et 1986, les ASM ont gardé un profil bas, comme la majorité de groupes unis par la parenté qui avaient conservé des chefferies agissantes en politique. Les conflits factionnels se sont exprimés souvent dans le cadre du foncier et autour de l’aide alimentaire d’urgence (Villasante 1998a, 2000d et 2000e).
— Le nouveau cadre « démocratique » en Assaba : 1986-1992
• Les élections municipales de 1986 impliquèrent une réactivation forte de la vie politique des groupes unis par la parenté dans tout le pays. Dans la ville de Kiffa, les groupes se organisèrent en deux factions, l’une menée par Muhammad Radhy et alliée aux groupes les plus importants de la région (Idawali, Laglal, Tajakant, Massuma et Ideybussat), et la seconde menée par l’un des frères de Muhammad Radhy, en alliance avec une faction de dissidence des Shratit. A ces deux pôles, ordinaires dans le cadre factionnel, vint s’ajouter un troisième, dirigé par le fils aîné de Muhammad Radhy, ce qui changea la donne dans la ville de Kiffa.
— Muhammad Mahmoud Ould Mouhammad Radhy (m. 2009), qui était un ami proche, s’était éloigné de la politique des ASM pour travailler dans le cadre national et syndical. Mais contrairement à ce qu’on pensait, il n’entendait pas revendiquer une place dans les jeux politiques de la confédération, mais plutôt proposer une alternative moderne aux électeurs citadins. Il était en effet le candidat progressiste du Mouvement national démocratique (MND), opposé aux courants traditionnels du pays, défenseur des hrâtîn et des Noirs mauritaniens.
• Cependant, au moment des élections, Muhammad Radhy et Muhammad Mahmud appuyèrent la candidature de Michel Vergès (m. 1996), des Jaafra par sa mère, qui fut élu premier maire de Kiffa. En 1990, lors des nouvelles élections, les deux pôles factionnels changèrent : Muhammad Radhy et ses alliés appuyèrent le candidat du gouvernement, Mukhtar Ould Busayf, des Shratit, faiblement représenté à Kiffa, qui remporta le scrutin ; alors que Muhammad Mahmud appuya la réélection du maire en place. J’ai analysé ces questions ailleurs (Villasante 2000d).
• Malgré les effets terribles des violences d’avril 1989 et de la campagne d’expulsions et d’exactions contre les Noirs mauritaniens, le régime de Taya prépara les élections présidentielles en autorisant la création des partis politiques le 15 avril 1991. A partir de ce moment, les élections auront un double cadre politique, l’un traditionnel et l’autre « moderne » représenté par les partis.
• Dans la région de l’Assaba et à Kiffa, la polarisation politique se concrétisa par le soutien au parti du régime, le Parti républicain, démocratique et social (PRDS), ou à l’Union des forces démocratiques (UFD). Muhammad Radhy fit campagne pour le PRDS et Muhammad Mahmud fit campagne pour l’UFD ; le premier remporta les élections, avec 72% des voix contre 21% pour l’UFD. Cependant, le taux d’abstention fut très important en Assaba, où votèrent seulement 35% des électeurs inscrits.
• En mars 1992, Muhammad Radhy trouva la mort brusquement alors qu’il se trouvait à Nouakchott, sa vie entière avait été consacré à l’affirmation de l’unité de la confédération des ASM, et son départ impliqua un grand rassemblement pour définir la suite des événements.
La jamaa des ASM convainquit son fils Muhammad Mahmud d’accepter sa nomination, et il fut intronisé nouveau chef de la confédération. Désormais, il devait abandonner ses activités syndicales et politiques pour devenir le porte-parole des ASM, suivant les décisions de la majorité de ses membres.
• La gestion de Mohammed Mahmud n’a pas été analysée dans ma thèse, aussi je me contenterai de dire ici qu’il a tenté de continuer l’œuvre de son père et de son grand-père aussi : renforcer l’adhésion à l’asabiyya confédérale, et continuer à protéger les plus faibles et les plus démunis.
En janvier 1994, il fut élu maire de la ville de Kiffa, avec le soutien des ASM et de l’Union des forces pour le changement. Son œuvre sociale fut très bien accueillie. Son départ accidentel, à Disag, hameau fondé par son père, le 28 mars 2009, a plongé sa famille, ses amis et tous ceux qui l’ont connu dans une grande tristesse ; un grand homme laissait ce monde brusquement en laissant derrière lui une vie exemplaire[1].
Son fils Sidi Mohammed a été élu nouveau chef confédéral, et il tente également de poursuivre l’œuvre de ses pères, renforcer l’identité de la confédération tout en l’insérant dans le monde politique moderne.
Épilogue
(1) Le cas des Ahl Sîdi Mahmûd montre que contrairement à l’idéologie courante et à certaines analyses, les statuts segmentaires ne sont pas immuables en Mauritanie, ils peuvent se transformer historiquement à l’intérieur même d’une collectivité toujours en relation avec les objectifs politiques des chefferies et les contextes historiques précis.
(2) Les groupes rattachés à la chefferie des ASM ont conservé leurs propres généalogies tout en reconnaissant leur solidarité avec la tente de chefferie de la confédération. La filiation reste donc fondamentale au niveau interne de chaque groupe et chaque fraction, mais c’est l’alliance politique qui fonde l’unité politique et identitaire des ASM.
(3) La cohésion et l’identité sociale chez les Ahl Sîdi Mahmûd restent assez fortes de nos jours et s’expriment autant sur le plan de la solidarité affective entre les membres de la confédération, que sur le plan de l’entraide en cas de besoin.
De nos jours, la cohésion des ASM joue un rôle important dans la scène politique locale et régionale. En effet, si les liens entre les groupes de la confédération et la chefferie dirigeante s’étaient distendus après la grande sécheresse sahélienne, l’installation du système démocratique, à partir de 1986, a réactivé puissamment les solidarités de parenté des ASM.
(4) En effet, de manière paradoxale, en Mauritanie la politique moderne a contribuée au réveil des liens de parenté et a réactivé aussi la vie politique interne, fondée toujours sur les clivages factionnels. Les adhésions aux partis se concrétisent dans ce cadre là, qui peut être classé comme néo-traditionnel, ou post-moderne.
Cela veut dire que les discours officiels qui condamnent les attachements aux « tribus » et aux « ethnies », qui devraient disparaître au profit de l’affirmation de la nation mauritanienne, ne correspondent pas à la réalité.
(5) Non seulement les discours officiels s’accompagnent des pratiques fondées sur l’appartenance aux groupes de parenté des Mauritaniens, mais de plus il est erroné de croire que l’identité nationale implique l’effacement des identités restreintes. Dans toutes les sociétés du monde, les identités locales et régionales coexistent avec l’identité nationale, parfois ancienne (Europe), parfois en voie de construction (Amérique latine).
(6) En Mauritanie, l’identité nationale est en cours de construction et d’affirmation, notamment après les années de violence politique. Mais elle se construit en conservant des identités plurielles : ethniques, de parenté, de village, de villes, de région… Et ce processus devrait continuer à s’affirmer dans le temps.
(7) L’analyse de la situation contemporaine des Ahl Sîdi Mahmûd a montré la grande plasticité de l’organisation sociale fondée sur la parenté dans un pays où elle ne peut pas être dissociée ni de l’État, ni de la future nation, tant sur le plan des représentations que sur celui des pratiques sociales. Cela d’autant plus que l’État ne développe pas une politique de modernisation fondée sur les valeurs républicaines d’égalité et de démocratie réelle.
Dr Mariella Villasante Cervello IDEHPUCP (Lima), Centre Jacques Berque (Rabat)
Séminaire organisé par le Centre universitaire d’études sahariennes de l’Université de Nouakchott, dirigé par le Dr Ahmed Maouloud Ould El Eydda
Musée nationale de Mauritanie, Nouakchott, le 15 décembre 2015
[academia.edu, Rabat le 28 décembre 2015]
Références bibliographiques
[*Revues à comité de lecture, **Chapitres de livres]
*1991a : Hiérarchies statutaires et conflits fonciers dans l’Assaba contemporain (Mauritanie). Rupture ou continuité ? Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée, 59-60, Aix-en-Provence, 1991 : 181-210.
http://www.persee.fr/doc/remmm_0997-1327_1991_num_59_1_2680?pageId=T1_209
https://www.academia.edu/4330372/Hiérarchies_statutaires_et_conflits_fonciers_dans_lAssaba_contemporain_Mauritanie_._Rupture_ou_continuité
*1992 : Quelques aspects sociaux et fonciers de l’oasis de Kurudjel, Région de l’Assaba, République Islamique de Mauritanie, Cahiers d’URBAMA n°6, Spécial Mauritanie, Tours, 1992 : 8-125.
1995 : Solidarité et hiérarchie au sein des Ahl Sîdi Mahmûd. Essai d’Anthropologie historique d’une confédération tribale mauritanienne, XVIIIè-XXème siècle, Thèse de doctorat en Anthropologie Sociale et ethnologie, 4 vol., 1528 pages (1329 pages de texte et 209 pages d’Annexes). École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris.
Laboratoire d’Anthropologie Sociale (las), umr 16, cnrs-Collège de France. Sous la direction de Pierre Bonte (Laboratoire d’Anthropologie Sociale, cnrs, Collège de France). Membres du jury : Emmanuel Terray (président), Pierre Bonte, Hélène Claudot-Hawad (Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman) et Abdel Wedoud Ould Cheikh (Université de Nouakchott).
— Reçue Docteur en Anthropologie sociale et Ethnologie le 8 décembre 1995, avec la mention
Très Honorable et les Félicitations du jury.
1995a : Transformations socioculturelles à Kiffa, Mauritanie, Peuples Méditerranéens n° 72-73, 1995 : 257-270.
*1996b : De l’adhésion religieuse au rattachement segmentaire : le processus d’émergence des Ahl Sîdi Mahmûd au XVIIIe siècle, Islam et sociétés au Sud du Sahara n°10 : 81-119.
https://www.academia.edu/4334850/De_ladhésion_religieuse_au_rattachement_segmentaire_le_processus_démergence_des_Ahl_Sîdi_Mahmûd_au_XVIIIe_siècle
*1997a : Genèse de la hiérarchie sociale et du pouvoir politique bidân, Cahiers d’Etudes Africaines, 147, XXXVII-3 : 587-633.
*1997b : La qabîla, l’imâra et l’Etat en Mauritanie : Introduction, et Parenté et politique en Mauritanie. Quelques aspects de la relation entre la qabîla et l’Etat à partir de l’exemple des Ahl Sîdi Mahmûd, The Maghreb Review Vol 22, “Tribal and Social Organisation”, 1-2 : 1-39.
1998a, Parenté et politique en Mauritanie. Essai d’anthropologie historique. Le devenir contemporain des Ahl Sîdi Mahmûd, confédération bidân de l’Assaba, Collection Sociétés Africaines, L’Harmattan, 284 p.
*1998b : La démocratie tribale en Mauritanie. Solidarité et factionnalisme politique dans la ville de Kiffa, Fascicule de recherches n°33, URBAMA : 115-125.
*1998c : La puissance politique du nasab en Mauritanie contemporaine. A propos du rôle d’intermédiation politique de l’élite dirigeante des Ahl Sîdi Mahmûd de l’Assaba, Nomadic Peoples, vol 2, 1-2 : 277-303.
https://books.google.co.ma/books?id=8CAv53wlHfoC&pg=PA129&lpg=PA129&dq=ahl+sidi+mahmoud&source=bl&ots=v1lSo6C9Wp&sig=ye36ioNod_Ld1HUdqCUWebcB8w8&hl=fr&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=ahl%20sidi%20mahmoud&f=false
*1999 : Mauritanie : Catégories de classement identitaires et discours politiques dans la société bidân, Annuaire de l’Afrique du Nord 1997, tome XXXVI : 79-100.
**2000c : La question des hiérarchies sociales et des groupes serviles chez les Bidân de Mauritanie, in M. Villasante-de Beauvais (éd.), Groupes serviles au Sahara : 277-322.
*2000d : Partis politiques “modernes” et factions “néo-traditionnelles” en Mauritanie. Quelques réflexions sur la parenté, le politique et la démocratie au sein de la société bidân, Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia (Barcelone) : 101-141.
*2000e : La puissance politique du nasab en Mauritanie contemporaine. A propos du rôle d’intermédiation politique de l’élite dirigeante des Ahl Sîdi Mahmûd de l’Assaba, Cahiers de l’IREMAM 13/14, Élites du monde nomade touareg et maure : 225-249. (Édition française, paru originellement dans Nomadic Peoples vol 2, 1-2 : 277-303).
https://www.academia.edu/3271849/La_Puissance_Politique_du_Nasab_en_Mauritanie_contemporaine._A_propos_du_rôle_dintermédiation_politique_de_lélite_dirigeante_des_Ahl_Sîdi_Mahmûd_de_lAssaba
**2002a : La quête de savoirs et de pouvoirs chez les Bidân de Mauritanie. Le cas de Lemrâbot Sîdi Mahmûd, fondateur de la confédération des Ahl Sîdi Mahmûd in H. Claudot-Hawad (dir.), Savoirs et pouvoirs au Sahara. Formation et transformation des élites du monde nomade, Éditions Paris-Méditerranée : 63-79.
**2002b, Quelques traits de la vie politique de Mokhtar Ould Daddah, premier président de la Mauritanie indépendante, The Maghreb Review, 27, 1, 2002 : 49–63.
*2003b : La place de la parenté dans le système politique mauritanien. Les termes du débat académique actuel, Annuaire de l’Afrique du Nord 2000-2001 : 3-26.
**2004c : They work to eat and they eat to work. M’allemîn Craftsmen Classifications and Discourse among the Mauritanian Bidân Nobility, (Traduit par Raymond Taylor), in : Customary Strangers : New Perspectives on peripatetic Peoples in the Middle East, Africa, and Asia, Joseph Berland and Aparna Rao (éds.), Praeger, Westport : 123-154.
**2006 : From the Disappearance of “tribes” to Reawakening of the Tribal Feeling : Strategies of State among the Formerly Nomadic Bidân (Arabophone) of Mauritania, (Traduit par Raymond Taylor), in Dawn Chatty (éd.), Nomadic Societies in the Middle East and North Africa: Entering the 21st Century, Queen Elizabeth House, Oxford, UK, Brill Academic Publishers, Leiden & Boston : 144-175.
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00825071/document
**2007a, (En collaboration avec Raymond Taylor), Introduction au livre Colonisations et héritages actuels au Sahara et au Sahel, M. Villasante Cervello (dir.) : 27-66.
**2007b, Quelques réflexions sur le devenir des catégories coloniales de classements collectifs : races, tribus, ethnies. La question des identités sociales élargies et restreintes, in M. Villasante Cervello (dir.), Colonisations et héritages actuels au Sahara et au Sahel, vol. I : 69-130.
https://www.academia.edu/3691776/Quelques_réflexions_sur_les_catégories_coloniales_de_classements_collectifs_races_tribus_ethnies._La_question_des_identités_sociales_élargies_et_restreintes
2014, Hommage à Mohammed Mahmoud Ould Mohammed Radhy, [Kiffa-Info, 2014]
https://www.academia.edu/19037969/Hommage_à_Mohamed_Mahmoud_ould_Mohammed_Radhy
Livres publiés sur la Mauritanie
PARENTÉ ET POLITIQUE EN MAURITANIE
Essai d’Anthropologie historique. Le devenir contemporain des Ahl Sîdi Mahmûd, confédération bidân de l’Assaba
Mariella Villasante Cervello, Préface de Pierre Bonte
Sociétés africaines et diaspora
Généralités, ouvrage de synthèse Afrique noire
Pour le sens commun occidental, les termes « parenté » et « politique » paraissent s’opposer, voire s’exclure l’un l’autre. Il en va autrement dans la pratique historique des sociétés arabes segmentaires, « tribales », pour lesquelles les liens généalogiques (nasab) sont étroitement liés au pouvoir politique.
Après trois ans de recherche de terrain en République Islamique de Mauritanie, l’auteur propose une autre vision des pratiques politiques observées dans ce pays du Maghreb extrême, situé entre le désert saharien et le Sahel atlantique. Il s’agit en particulier de montrer que l’ordre de la parenté ne s’oppose guère à l’ordre politique étatique, mais qu’en Mauritanie, les deux ordres socio-politiques sont étroitement associés.
ISBN : 2-7384-6392-4 • Février 1998 • 282 pages
Mariella Villasante-de Beauvais (Sous la direction de)
Dans le monde contemporain, dominé par les valeurs de liberté et d’égalité sociale, parler de « groupes serviles », de « relations serviles », d’« esclavage » parait anachronique, si ce n’est scandaleux.
C’est probablement pour cette raison que le thème reste peu étudié et surtout sujet à de forts tabous dans la plupart des pays concernés, au Sahara, en Afrique et ailleurs. Le cas mauritanien est ainsi régulièrement dénoncé comme le paradigme de la permanence de relations hiérarchiques et serviles.
Au-delà de ces accusations qui s’appuient souvent sur des images simplistes et faussées alimentant les préjugés occidentaux sur la « sauvagerie des Africains » ou la « fatalité du destin des esclaves », comment saisir la réalité plus complexe des sociétés hiérarchiques ? L’objectif de cet ouvrage collectif est de dresser un premier état des lieux de la situation historique et contemporaine des groupes serviles au Sahara à partir du cas de la société arabophone (bidân) de Mauritanie.
L’ensemble des contributions remet en cause un certain nombre d’idées et d’analyses conventionnelles sur la question, en particulier celles qui considèrent que les hiérarchies et les statuts « serviles » seraient fixes et rigides, associés à un phénotype, et se reproduisant depuis des siècles ad vitam aeternam. C’est une réalité bien distincte qui est ici mise au jour, faite de fluidité, de changement, de mobilité forte et d’un grand métissage culturel et social entre les groupes « libres » et « serviles ».
Broché: 359 pages
Éditeur : CNRS Editions, 13 juillet 2000
Collection : Études de l’Annuaire de l’Afrique du Nord
Langue : Français
ISBN-10: 2271056845
ISBN-13: 978-2271056849
Problèmes conceptuels, état des lieux et nouvelles perspectives de recherche (XVIIIè-XXè siècles) Volume I
Sous la direction de Mariella Villasante Cervello, avec la collaboration de Christophe de Beauvais – Préface de C. Coquery-Vidrovitch
HISTOIRE AFRIQUE NOIRE, Cap Vert, Gambie, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Sénégal, Sahara occidental
Cet ouvrage propose une nouvelle manière d’analyser la question coloniale et les héritages contemporains post-coloniaux dans la région saharo-sahélienne de l’Afrique, en prêtant une attention spéciale aux cadres comparatifs et interdisciplinaires. Les 24 contributions d’historiens, d’anthropologues et de politistes portent sur les problèmes conceptuels de l’étude des colonisations en Afrique, sur le fait colonial lui-même et enfin sur les héritages contemporains.
ISBN : 978-2-296-04024-3 • Novembre 2007 • 544 pages
Mariella Villasante Cervello
ISBN : 978-2-296-04025-0 • Novembre 2007 • 554 pages
LE PASSÉ COLONIAL ET LES HÉRITAGES ACTUELS EN MAURITANIE
État des lieux de recherches nouvelles en histoire et anthropologie sociale
Sous la direction de Mariella Villasante Cervello avec la collaboration de Christophe de Beauvais
Études africaines
ANTHROPOLOGIE, ETHNOLOGIE, CIVILISATION HISTOIRE AFRIQUE NOIRE Mauritanie
Le passé historique colonial reste un territoire sujet à des inventions et à des re-créations idéologiques, souvent à des fins politiciennes, c’est pourquoi cet ouvrage collectif cherche à proposer une nouvelle manière d’analyser la question coloniale et les héritages contemporains postcoloniaux en Mauritanie. L’horizon temporel couvre les XIXe, XXe et XXIe siècles.
ISBN : 978-2-343-01767-9 • Décembre 2014 • 572 pages
[1] Voir l’hommage que j’ai écrit à sa mémoire (Villasante 2014).