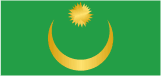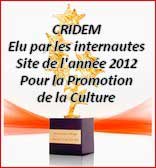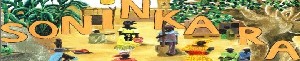16-05-2025 11:13 - Mauritanie : Khally Diallo, « Pour moi, la politique n’est pas un métier, mais un devoir de citoyenneté ! »

Ceux qui font l'Afrique - Dans cette interview Khally Diallo député sur la liste nationale des jeunes, par ailleurs président de la Commission des Affaires Économiques au sein de l’ Assemblée nationale, s’exprime pour notre magazine sur son engagement à défendre « les intérêts du peuple, et plus spécifiquement ceux de la jeunesse » et l’apport des jeunes dans la marche de la bonne gouvernance.
Khally Mamadou Diallo, comment vous présentez-vous à nos lecteurs ?
Je suis Khally Mamadou Diallo, député du peuple et actuellement président de la Commission des Affaires Économiques au sein de notre Assemblée nationale.
Issu de la liste des jeunes, je tiens à souligner l’importance de cette représentation, qui n’est pas simplement symbolique, mais un véritable appel à l’action pour intégrer la voix et les aspirations de la jeunesse dans le processus législatif et décisionnel de notre pays. Mon mandat est celui de l’espoir et de l’ambition pour une Mauritanie moderne, dynamique et équitable. Dans le cadre de mes fonctions, et plus particulièrement à la tête de la Commission des Affaires Économiques, j’œuvre sans relâche pour promouvoir des politiques économiques audacieuses et inclusives.
J’ai un engagement ferme à travailler en étroite collaboration avec l’ensemble de mes collègues de l’opposition,
Car c’est dans l’unité et la complémentarité que réside la force de notre institution.
Quel bilan faites-vous de votre mandat depuis les législatives de mai 2023 en tant que tête de liste des jeunes à l’Assemblée nationale ?
Alors ma vision est de participer activement à la construction d’une Mauritanie où chaque citoyen, en particulier les jeunes, trouve sa place et peut contribuer pleinement à l’édification d’un avenir prospère et serein.
C’est difficile de dresser un bilan complet et exhaustif de notre travail au sein de l’Assemblée nationale, mais il est tout à fait possible de faire une appréciation globale de notre situation et de nos actions. Il convient d’abord de rappeler, avec clarté, que je suis membre de l’opposition.
Au sein de cette Assemblée, nous sommes 176 députés, dont seulement 27 issus de l’opposition. Il en résulte une majorité absolue et mécanique qui permet au gouvernement de faire adopter, presque systématiquement, tous les projets de loi qu’il soumet. En effet, chaque proposition de loi, qu’elle soit de nature économique, sociale ou politique, bénéficie d’une large majorité qui soutient sans réserve les initiatives gouvernementales. Cette réalité rend notre travail d’autant plus complexe, car, bien souvent, nous nous retrouvons dans la position de devoir nous opposer à des décisions qui semblent prises à l’avance, sans véritable dialogue ou concertation.
Il faut souligner que, depuis mon arrivée dans cette Assemblée, les projets de loi que nous débattons proviennent principalement du gouvernement, ce qui ne nous laisse que peu d’espace pour proposer des alternatives ou des amendements significatifs. Notre rôle d’opposants est donc de faire entendre la voix de ceux qui n’ont pas la possibilité d’exprimer leurs préoccupations dans les sphères de décision, de pointer les contradictions, les incohérences, voire les injustices dans certaines propositions, et de rappeler sans relâche les besoins et les attentes des populations.
Nous devons reconnaître que l’Assemblée nationale semble, par moment, fonctionner essentiellement comme un instrument au service du pouvoir exécutif.
Toutefois, cela ne signifie pas que nous, membres de l’opposition, devons-nous taire ou nous résigner. Nous avons pour mission de mettre en lumière les réalités de terrain, de dénoncer les failles des projets de loi et de proposer des solutions alternatives qui, nous en sommes convaincus, répondent mieux aux aspirations profondes de notre peuple.
Chaque projet de loi soumis par le gouvernement est une occasion pour nous de questionner les choix effectués, de pointer du doigt les contradictions qui existent entre les discours officiels et la réalité du quotidien des Mauritaniens. C’est dans cet esprit que nous accomplissons notre rôle de députés de l’opposition qui est de défendre les intérêts du peuple, faire valoir les enjeux qui ne sont pas pris en compte par les autres, et tenter d’influencer les décisions dans un sens plus équitable et plus juste pour tous.
Je crois profondément que notre rôle, même dans une situation où nous faisons face à une majorité mécanique, est essentiel pour la bonne marche de notre démocratie. Nous ne devons jamais perdre de vue l’objectif de faire avancer les idées, de poser les bonnes questions et, surtout, de rappeler que la véritable mission de cette Assemblée est d’être au service de l’ensemble des citoyens, sans distinction.
En tant que député de l’opposition, comment faites-vous pour porter la voix des jeunes ?
En tant que député de l’opposition, mais également élu sur la liste nationale des jeunes, je tiens à souligner avec fierté et responsabilité l’importance de ma mission au sein de cette Assemblée. Mon engagement est, avant tout, celui de défendre les intérêts du peuple, et plus spécifiquement ceux de la jeunesse qui est, pour moi, l’un des moteurs essentiels du développement de notre nation.
Il convient de rappeler que c’est la première fois dans l’histoire politique de notre pays que 11 jeunes ont été élus à l’Assemblée nationale par le biais de la liste nationale des jeunes, dans le cadre du système proportionnel. Cet événement marque une étape importante dans l’inclusion des jeunes dans les instances décisionnelles de notre pays. Cela témoigne d’une prise de conscience collective quant à la nécessité de donner aux jeunes une voix forte, capable de porter leurs préoccupations et leurs aspirations, dans la sphère politique.
Dans ce contexte historique, je m’efforce, à chaque instant, de remplir mon rôle avec conviction et dévouement. En tant que représentant de cette génération, je m’efforce de mettre en lumière les défis auxquels nous faisons face, de défendre des politiques qui soutiennent l’éducation, l’emploi, l’entrepreneuriat et l’inclusion des jeunes dans les processus de prise de décision. Mon engagement est aussi celui de rappeler que la jeunesse n’est pas une question de chiffres ou de représentation symbolique, mais une question de véritable impact dans les décisions qui façonnent l’avenir de notre pays.
Cela dit, il serait naïf de croire que tout est acquis. Bien que notre voix soit aujourd’hui entendue, il reste encore beaucoup à faire pour que nos préoccupations soient véritablement prises en compte dans toutes les politiques publiques. Parfois, malgré la légitimité de nos demandes et la force de nos arguments, beaucoup de nos recommandations ne sont pas suivies d’effet.
Cependant, je reste convaincu que notre présence dans cette Assemblée permet déjà de briser de nombreux tabous et de créer une dynamique nouvelle. Chaque intervention, chaque proposition est une pierre de plus dans la construction d’une Mauritanie qui prenne en compte les aspirations et les besoins des jeunes.
Après il ne faut pas céder à la facilité et de toujours chercher à aller au-delà des attentes immédiates, en restant fidèle à nos principes et à notre mission de service public. Nos revendications, bien qu’elles ne soient pas toujours suivies d’actions immédiates, ont le mérite de faire avancer le débat et de poser les bases d’une réflexion plus large sur le rôle que doivent jouer les jeunes dans la gouvernance de notre pays.
Je m’engage à poursuivre cette tâche avec la même détermination et le même sens de l’intérêt général, afin que la jeunesse, non seulement de la capitale, mais aussi des régions les plus reculées, puisse enfin s’épanouir pleinement et participer activement à l’édification de la Mauritanie de demain.
Quelles sont les lois majeures que vous avez défendues depuis votre élection ?
Dans le cadre de mon engagement à la fois en tant que député et représentant de la jeunesse, j’ai entrepris plusieurs actions innovantes visant à sensibiliser et à impliquer davantage nos concitoyens, en particulier les jeunes, dans le travail parlementaire. En effet, il est essentiel de comprendre que, trop souvent, la jeunesse en Mauritanie demeure éloignée des débats parlementaires et sous- estime l’importance de cette institution dans la construction de notre avenir collectif. Il devient donc primordial d’attirer leur attention sur la nature et le rôle crucial de l’Assemblée nationale dans la définition des politiques publiques.
Dans cette optique, j’ai fait le choix de profiter de mes prises de parole en séance pour sensibiliser le public, en particulier les jeunes, aux enjeux parlementaires. Il est important de leur faire comprendre que les décisions prises ici affectent directement leur quotidien, qu’il s’agisse de l’éducation, de l’emploi, de la santé ou de la gouvernance. Mon objectif est de rendre le travail parlementaire plus accessible et de renforcer le lien entre les institutions et la population.
Bientôt, je lancerai également des sessions en direct sur les réseaux sociaux, afin de discuter de l’importance de certains projets de loi, d’en expliquer les implications et, le cas échéant, de pointer leurs faiblesses. Ces interventions auront pour but de rendre le processus législatif plus transparent, de susciter un débat public informé et d’encourager une participation active de la jeunesse dans les décisions qui façonnent notre société. Cette initiative s’inscrit dans une démarche de démocratisation de l’information, visant à mieux impliquer la population dans le processus législatif.
Enfin, conscient de ma responsabilité sociale, je m’engage chaque année à investir une partie substantielle de mon salaire dans des actions caritatives et éducatives. Cet engagement personnel reflète ma conviction que nous devons, en tant que représentants du peuple, être directement impliqués auprès des populations les plus vulnérables. À travers ces actions, je souhaite non seulement apporter un soutien concret, mais aussi montrer l’exemple : un député doit être à la fois un législateur et un acteur engagé auprès des citoyens.
En somme, ces différentes actions visent à renforcer la participation des jeunes et des citoyens à la vie politique, à rendre le travail législatif plus compréhensible et accessible, et à prouver que notre rôle en tant qu’élus va bien au-delà de la simple fonction parlementaire, en étant aussi un vecteur de solidarité et de progrès social.
Quelles sont les actions innovantes que vous avez mises en place ou que vous envisagez en concertation avec les jeunes ?
Au cours de mon mandat en tant que député, j’ai eu l’opportunité de contribuer activement aux débats et aux travaux législatifs, en effectuant plusieurs amendements sur divers projets de loi examinés au sein des différentes commissions. Ces amendements ont porté sur des sujets d’importance qui, je l’espère, ont permis de mieux prendre en compte les réalités sociales, économiques et politiques de notre pays.
Cependant, il me semble également essentiel de préparer, dans les mois à venir, des propositions de lois plus concrètes et structurées, qui répondent aux préoccupations profondes de notre société. Je suis en train de travailler sur ces initiatives, car il est important, en tant que représentant du peuple, de ne pas se contenter d’amendements ponctuels, mais de proposer des réformes ambitieuses et structurantes qui auront un véritable impact sur la vie des Mauritaniens.
L’année et demie qui viennent de s’écouler m’a permis de mieux appréhender les dynamiques internes de cette Assemblée, de comprendre les rouages de son fonctionnement, ainsi que les contraintes auxquelles nous faisons face. Ce temps d’observation et d’adaptation m’a permis de poser mes marques, de m’ancrer dans le travail législatif, avant de m’engager pleinement dans une véritable bataille politique au sein de l’hémicycle. Ce temps d’apprentissage était nécessaire, car il est crucial d’être à la fois réfléchi et stratégique avant de proposer des projets de loi qui ne se contentent pas seulement de répondre à l’urgence, mais qui visent à répondre aux défis à long terme de notre société.
Vous fustigez les inégalités sociales. Comment expliquer cette réalité dans la société mauritanienne ?
Je ressens profondément la réalité des inégalités sociales qui marquent notre société. En Mauritanie, l’injustice sociale est bien plus qu’une simple perception ; elle est une vérité vivante, quotidienne, que l’on retrouve dans chaque recoin de notre nation. Les inégalités de chance sont devenues la norme, et l’écart entre les différents groupes sociaux ne cesse de se creuser. Cette situation est d’autant plus préoccupante qu’elle touche les secteurs fondamentaux de la vie humaine : l’éducation, la santé, l’accès à l’emploi et aux services de base.
Les causes de ces inégalités sont multiples et ancrées dans l’histoire de notre pays. D’abord, nous devons reconnaître que la structure sociale et économique de la Mauritanie est encore marquée par des héritages coloniaux et des hiérarchies traditionnelles qui perdurent, notamment à travers des clivages ethniques, régionaux et socio-économiques. Ces inégalités historiques se traduisent par une distribution inéquitable des ressources, qui empêche de nombreux Mauritaniens d’accéder aux mêmes opportunités.
Ensuite, les politiques publiques mises en place ces dernières décennies n’ont pas été suffisamment inclusives. L’accès à une éducation de qualité reste réservé à une élite, tandis que de vastes pans de la population sont condamnés à une marginalisation sociale et économique. L’absence de mesures concrètes pour soutenir les populations les plus vulnérables, qu’il s’agisse des jeunes des zones rurales, des femmes ou des communautés dites « minoritaires », exacerbe davantage ces fractures sociales.
Le manque d’une véritable réforme du système de redistribution des richesses, couplé à une corruption systémique, empêche également l’ascension sociale pour une grande majorité de nos compatriotes. Ceux qui naissent dans la pauvreté sont souvent condamnés à la reproduire, faute d’une politique inclusive et d’un investissement dans les secteurs stratégiques tels que l’éducation, la formation professionnelle et l’égalité des chances.
Cette situation, qui est aussi une injustice criante, ne peut perdurer. Il est impératif de remettre en question le modèle actuel et de mettre en place des réformes structurelles. Cela passe par une redistribution équitable des ressources, par l’amélioration de l’accès à une éducation de qualité pour tous, et par des mesures concrètes pour promouvoir l’égalité des chances dans tous les domaines de la vie nationale.
Le changement est possible, mais il nécessitera un engagement politique fort et la volonté de remettre l’humain au cœur des préoccupations. Nous devons construire une Mauritanie plus juste, où chaque citoyen, indépendamment de son origine, de son statut social ou de sa condition, puisse aspirer à un avenir meilleur. C’est cet idéal de justice et d’équité qui guide mon engagement politique, et je m’y consacrerai sans relâche jusqu’à ce que nous bâtissions ensemble une société plus équilibrée et plus humaine.
Quels sont, selon vous, les ingrédients du vivre ensemble entre les différentes communautés de la Mauritanie ?
Le vivre ensemble en Mauritanie, entre nos différentes communautés, est une question importante pour la stabilité, la paix et le développement de notre pays. La diversité ethnique, culturelle de la Mauritanie constitue une richesse, mais elle exige des efforts constants pour garantir une coexistence harmonieuse. À cet égard, plusieurs ingrédients me semblent essentiels pour favoriser ce vivre ensemble.
1. La promotion de l’égalité des droits et des opportunités
Il est fondamental que chaque citoyen, quelle que soit son origine ethnique, ou sa situation sociale, puisse jouir des mêmes droits. Cela inclut l’accès à l’éducation, à l’emploi, à la justice et aux services publics. L’égalité des chances est le fondement d’une société inclusive et juste, où chacun se sent respecté et valorisé.
2. Le renforcement de l’État de droit
Le respect de la loi est un principe essentiel pour éviter toute forme de discrimination. Il faut que les institutions judiciaires, les autorités publiques et les forces de sécurité assurent une application équitable de la loi, sans distinction d’origine ou de statut social. La lutte contre l’impunité et la corruption est aussi cruciale pour instaurer une confiance mutuelle entre les communautés.
3. La promotion de la culture de la paix et de la tolérance
Il est impératif de renforcer les valeurs de tolérance, de respect et de dialogue entre les communautés. Cela passe par des programmes éducatifs qui mettent l’accent sur la diversité, l’histoire commune et les principes de coexistence pacifique. Les jeunes, notamment, doivent être formés à la gestion de la diversité et à la résolution pacifique des conflits.
4. La préservation et la valorisation de la diversité culturelle
La Mauritanie est un pays riche à travers sa diversité, chacun ayant ses spécificités. Plutôt que de chercher à uniformiser cette diversité, il est nécessaire de la valoriser, de la préserver et de la célébrer. Cela peut se faire à travers des politiques culturelles inclusives, la reconnaissance des langues nationales, et la promotion des traditions de chaque communauté.
5. La solidarité sociale et la coopération intercommunautaire
Le vivre ensemble ne peut se construire sans une solidarité forte entre les différentes communautés. Les programmes de développement doivent être conçus de manière à bénéficier équitablement à toutes les régions et à tous les groupes sociaux. De plus, il est important d’encourager la coopération entre les communautés à travers des projets communs, que ce soit dans l’agriculture, l’éducation ou d’autres secteurs.
6. Le dialogue politique et social
Les autorités politiques doivent continuer à faciliter le dialogue entre les leaders communautaires, les partis politiques et la société civile. Il est essentiel de maintenir des espaces de concertation où les différents groupes peuvent exprimer leurs préoccupations et trouver des solutions communes. Ce dialogue est aussi un moyen de prévenir les tensions et de renforcer la cohésion nationale.
Pour finir, le vivre ensemble en Mauritanie nécessite un engagement collectif et une vision inclusive, où les différences sont perçues comme une richesse et non comme une source de division. L’État doit jouer un rôle de garant de la justice et de l’égalité, mais les citoyens, les communautés et les leaders doivent également prendre leur part de responsabilité pour faire vivre ces principes au quotidien.
Quel commentaire faites-vous du départ massif des jeunes Mauritaniens vers les USA ces derniers temps ?
C’est une situation déplorable, qui me touche profondément, je considère le départ massif des jeunes Mauritaniens vers les États-Unis comme un phénomène préoccupant. Cela témoigne d’une fuite de notre population active et même des cerveaux, résultant souvent d’une insatisfaction face à la situation socio-économique, à la recherche de meilleures opportunités et de conditions de vie.
Ceci montre clairement que le gouvernement a échoué lamentablement et qu’il n’y a pas de politique de jeunesse.
Il est crucial que le gouvernement, redouble d’efforts pour créer un environnement favorable à l’épanouissement des jeunes ici, en investissant dans l’éducation, l’emploi et les infrastructures, afin de retenir notre capital humain et éviter cette émigration massive.
Comment, selon vous, mieux répondre aux attentes des jeunes ?
Tout d’abord il faut renforcer la bonne gouvernance par la voix des jeunes cela nécessite de les inclure davantage dans les processus décisionnels. Il faut créer des mécanismes formels permettant aux jeunes de participer activement à la politique, comme des conseils consultatifs ou des forums de discussion. De plus, il faut encourager la transparence et la responsabilité des dirigeants en utilisant les technologies numériques pour faciliter l’accès à l’information et permettre un contrôle citoyen. En donnant aux jeunes les moyens d’agir et de s’exprimer, nous les impliquons dans la construction d’une gouvernance plus juste et plus responsable.
Comment renforcer la bonne gouvernance par la voix des jeunes ?
Étant nouveau Député élu sur la liste des jeunes dans l’opposition, mes principaux défis sont multiples et urgents. D’abord, il s’agit de lutter contre les injustices sociales et économiques qui freinent le développement de notre pays, notamment en matière d’accès à l’éducation, à l’emploi et à la santé. Ensuite, il est important pour moi de promouvoir une véritable bonne gouvernance, en exigeant davantage de transparence et de responsabilité de la part des institutions publiques.
L’émancipation des jeunes est également au cœur de mon mandat. C’est impératif de leur offrir plus de possibilités de s’engager dans la vie politique, économique et sociale, tout en combattant la violence sous toutes ses formes, qu’elle soit physique, psychologique ou institutionnelle.
Enfin, le développement durable de la Mauritanie reste une priorité. Nous devons investir dans les infrastructures, la technologie et l’agriculture pour créer des emplois et réduire les inégalités régionales. Ce travail nécessite une mobilisation collective et une vision claire pour un avenir meilleur pour notre nation.
Quels sont les principaux défis de votre mandat ?
Les défis majeurs de mon mandat sont multiples et nécessitent une approche stratégique et déterminée. Le premier défi auquel je me confronte est la question de la représentation de l’opposition à l’Assemblée nationale. La faiblesse actuelle de l’opposition dans les débats parlementaires et l’absence d’une véritable pluralité des voix rendent difficile l’exercice d’un contrôle efficace sur l’action du gouvernement. L’Assemblée nationale, dans son état actuel, semble parfois n’être qu’une simple boîte d’enregistrement, où les décisions sont prises sans une réelle confrontation des idées.
Pour que le Parlement puisse pleinement remplir son rôle de contre-pouvoir, il faut rétablir un équilibre entre la majorité et l’opposition.
Cela passe par un renforcement des capacités de l’opposition à participer activement aux débats, à présenter des propositions alternatives et à veiller à la transparence des actions gouvernementales. La population mauritanienne doit comprendre que le Parlement n’est pas un lieu où l’on se contente de ratifier les décisions prises ailleurs. Il est un outil fondamental pour la démocratie, un levier de contrôle et de régulation qui permet de garantir que le pouvoir exécutif ne se déploie pas sans contrepoids.
Le deuxième défi est lié à la mobilisation de la jeunesse. La jeunesse mauritanienne, qui représente une part importante de la population, doit être non seulement informée, mais également activement impliquée dans la vie politique. Il est crucial que les jeunes s’engagent dans le débat public, non pas de manière passive ou éphémère, mais avec des principes solides, des convictions patriotiques et une vision claire pour l’avenir de notre pays. Les jeunes ne doivent pas se limiter à être spectateurs, mais doivent être les acteurs du changement, en prenant des responsabilités et en assumant des rôles de leadership.
Dans ce cadre, mon mandat est aussi un défi de pédagogie et de mobilisation. Il faut éduquer les jeunes à la politique, à l’importance du Parlement et à la nécessité de défendre des idéaux forts pour l’avenir de notre nation. En parallèle, nous devons œuvrer pour une représentation plus inclusive de la jeunesse, tant à l’Assemblée qu’au sein des autres institutions du pays, afin que les décisions qui se prennent aujourd’hui prennent en compte leurs aspirations et leurs réalités.
En résumé, les deux principaux défis de mon mandat sont d’une part la nécessité de renforcer le rôle de l’opposition et d’autre part d’encourager un engagement politique fort et réfléchi de la jeunesse, car ce sont eux qui, demain, porteront les destinées de notre pays.
L’élection présidentielle de cette année vous a laissé un goût amer. Si oui, pourquoi ?
Oui, l’élection présidentielle de cette année m’a laissé un goût amer, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il est évident qu’un hold-up électoral a eu lieu, avec des irrégularités flagrantes et des résultats qui ne reflètent pas la volonté populaire. Nous avons observé une manipulation des scrutins et des fraudes qui ont entaché la crédibilité de tout le processus électoral. Cela constitue un véritable déni de démocratie et un affront à l’expression libre des citoyens.
En outre, au sein de l’opposition, les divergences sont certes visibles, mais elles ne doivent pas masquer l’unité sur les principes fondamentaux de justice, de transparence et de respect des droits humains. Cependant, ces divisions affaiblissent notre capacité à résister efficacement aux abus de pouvoir et à mener une véritable lutte pour la démocratie.
Un autre aspect profondément choquant reste le décès tragique de plusieurs jeunes lors des manifestations et des troubles qui ont suivi les élections. Leur mort, ainsi que l’absence d’enquête publique sérieuse pour établir les responsabilités, témoigne d’une totale impunité. Les autorités, en particulier les forces de sécurité, doivent rendre des comptes sur ces événements et permettre à la vérité d’éclater.
C’est donc un mélange de frustration, de colère et de désillusion qui caractérise mon ressenti face à cette élection. Le combat pour la vérité, la justice et l’émancipation de notre peuple reste plus que jamais d’actualité.
Vous êtes surnommé par plusieurs jeunes activistes africains le « Ousmane Sonko de la Mauritanie ». Est-ce un signe du destin ?
Je tiens d’abord à dire que je respecte le parcours de Ousmane Sonko, qui est aujourd’hui une véritable figure politique au Sénégal. Son parcours, sa détermination et son engagement pour un avenir meilleur pour son pays inspirent des milliers de jeunes à travers l’Afrique. Ousmane Sonko est effectivement devenu un mentor pour de nombreux jeunes activistes et militants politiques, un modèle de résistance face aux injustices et aux dérives du pouvoir. Sa capacité à incarner l’espoir d’un renouveau démocratique fait de lui un acteur majeur de la politique sénégalaise.
Cela étant dit, je suis avant tout Khally Diallo, un jeune patriote mauritanien, animé par la conviction profonde que notre pays mérite mieux. Je ne cherche pas à imiter ou à emprunter le chemin d’un autre. Mon engagement est celui d’un Mauritanien déterminé à transformer positivement notre nation. Je crois profondément en ce pays, en son potentiel et en sa jeunesse. Pour moi, la politique n’est pas un métier, mais un devoir de citoyenneté. C’est une responsabilité de servir, de guider et de bâtir un avenir meilleur pour nos enfants et les générations futures.
Mon ambition, c’est de tracer ma propre route, avec courage et vérité, loin des calculs politiciens et des intérêts personnels. Je veux faire de la politique un acte de sacrifice et de service, non un moyen d’atteindre des privilèges. C’est ce qui guide mon engagement : la volonté de défendre les intérêts du peuple mauritanien, de lutter pour la justice, pour l’égalité des chances et pour un avenir où chaque Mauritanien pourra s’épanouir, indépendamment de son origine ou de son statut.
Ce qui compte pour moi, c’est d’être fidèle à mes convictions, de rester fidèle à la Mauritanie, et de me battre pour qu’elle devienne un modèle de démocratie, de progrès et d’unité. Ousmane Sonko est une réalité politique au Sénégal, mais moi, je suis Khally Diallo, un jeune mauritanien, déterminé à écrire ma propre histoire et à offrir aux générations futures un pays plus juste et plus solidaire.
Comment voyez-vous la Mauritanie dans 10 ans ?
La Mauritanie dans 10 ans, c’est un pays qui aura tourné la page du pouvoir militaire. Ce sera un pays où la démocratie ne sera pas une promesse, mais une réalité vivante, où la justice sera véritablement accessible à tous et où chaque citoyen pourra aspirer à une vie meilleure. Dans ce pays, l’accès à un emploi décent sera une chance offerte à tous, sans discrimination ni favoritisme. Mais pour y parvenir, cela ne pourra se faire que si le peuple, et en particulier nos jeunes, se réveille et se mobilise pour changer les choses.
Aujourd’hui, la jeunesse mauritanienne a un rôle fondamental à jouer. Nous sommes à un tournant de notre histoire, et il est essentiel que les jeunes, qui sont notre avenir, prennent pleinement conscience de la nécessité de s’impliquer dans la politique et dans la gestion de notre pays. C’est grâce à une mobilisation collective, une prise de conscience de notre force et de notre potentiel, que nous pourrons bâtir un pays où la corruption, l’injustice et l’impunité n’auront plus leur place.
Nous avons une richesse incroyable : nos ressources naturelles, mais aussi nos jeunes talents. Il est grand temps que nos cadres, nos ingénieurs, nos enseignants, nos entrepreneurs, aient la place qu’ils méritent pour contribuer pleinement à l’essor du pays. Leur potentiel doit être valorisé, leur expertise doit être mise à profit pour faire de la Mauritanie une nation prospère et respectée.
Enfin, notre pays doit incarner le « vivre-ensemble » au quotidien. Cela passe par l’acceptation des différences, qu’elles soient culturelles ou ethniques. Unis dans la diversité, nous devons bâtir un avenir commun où chaque Mauritanien, peu importe son origine ou son statut, trouve sa place.
Nous avons un chemin à parcourir, mais ensemble, avec courage et détermination, nous pouvons construire une Mauritanie fière de son histoire, juste, moderne et ouverte sur le monde. Il est temps de nous lever pour transformer notre pays en un modèle de démocratie et de bien-être.
Propos recueillis par / Awa Seydou