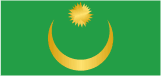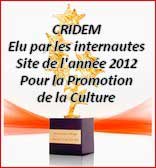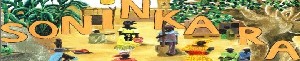22-03-2008 10:34 - Bref exposé sur la mondialisation

Introduction
La mondialisation est un phénomène qui est l'objet de nombreux commentaires ou analyses. Certains milieux la disent "heureuse", voire génératrice de progrès, et font tout pour la faciliter. Par contre, elle est aussi à l'origine d'un courant de pensée dit "altermondialiste", auquel nous nous rattachons, et pour lequel la mondialisation est une réalité dont les conséquences se font ressentir de manière très négative.
La mondialisation libérale et capitaliste
Eluder le fait que la mondialisation soit capitaliste et la réduire à son aspect libéral, ne permet pas de comprendre le phénomène dans sa globalité. Cela réduit les possibilités d'analyses, et par suite l'approfondissement des propositions alternatives.
Caractéristiques de la mondialisation
- Internationalisation croissante des échanges.
- Croissance du capital financier (marché des euros-dollars dès 1957) aboutissant à une dérèglementation financière qui commence au début des années 70 avec l'abandon des règles de parité stable entre les monnaies. Cette croissance s'accompagne d'un rôle de plus en plus important du capital financier dans la production de biens et services.
- Internationalisation de la production, et montée en puissance des sociétés transnationales à partir des années 80. Grâce aux progrès des moyens de communication, on peut concevoir un produit dans un bureau d'étude et le faire fabriquer à moindre coût dans une usine située ailleurs sur la planète. Grâce à la baisse des coûts de transport, il peut maintenant être très avantageux de produire dans des pays même très éloignés.
Peut-on sérieusement accuser nos gouvernements d'union d'avoir agi uniquement par pur dévouement à l'idéologie néolibérale ? Quelles raisons profondes motivaient alors leur politique d'ouverture au capitalisme financier ?
Dans le contexte de cette crise qui débute dans les années 70 et qui dure toujours, il apparaît dans l'intérêt de chaque pays d'ouvrir ses frontières pour exporter les capitaux financiers de ses nationaux et leur permettre de dégager du profit . Seulement le capital financier n'est que la contrepartie de capital industriel, c'est à dire d'usines et de marchandises, et la libéralisation financière ne peut que s'accompagner de la libéralisation des échanges de biens et services. C'est alors tout un ensemble de mécanismes qui se déclenchent à partir des années 70.
- les entreprises nationales sont mises en concurrence directe avec les entreprises étrangères. Ce qui entraîne des restructurations dévastatrices pour l'emploi.
- les capitaux financiers sont mis en concurrence de plus en plus forte, et leurs propriétaires ou gérants jouent un rôle de plus en plus grand dans la gestion des entreprises, ils font tout pour maximiser les profits.
- les Etats sont mis en concurrence : pour que les entreprises nationales soient compétitives il importe que leur coût de production soit le plus bas possible. Ce mécanisme est à l'origine d'un dumping économique et social qui entraîne pressions sur les salaires et les conditions de travail, chômage, précarité, atteintes aux acquis sociaux, etc. Ce sont alors les salariés nationaux qui se trouvent mis en concurrence directe avec les salariés étrangers et plus particulièrement avec ceux qui ont les revenus les plus bas de la planète.
Certes, il peut sans doute exister des instruments de régulation permettant de compenser certaines conséquences particulièrement dévastatrices, mais qu'est-ce qui peut contrarier la logique de profit et de croissance du capital financier ? Où cette logique entraîne-t-elle notre système socio-économique, et nous avec ? On peut aussi s'interroger sur les alternatives possibles. En existe-t-il ? Peut-on imaginer des pistes de réflexion qui pourraient nous conduire à en construire ?
Le débat est jusqu'à maintenant ouvert sur cette question.
Moctar ould sidi ali.
Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité.