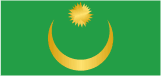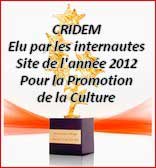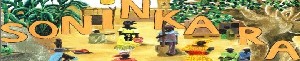20-05-2013 19:39 - Télécoms : L’économie qui monte

A n’en pas douter, l’arrivée de la téléphonie mobile a provoqué une révolution dans les mœurs communicationnelles des Mauritaniens. Les prévisions les plus optimistes à l’arrivée des deux premiers opérateurs (Mattel et Mauritel) n’ont pas prévu un tel développement.
Elles n’ont surtout pas pu envisager ce qui constitue aujourd’hui une sorte de "valeur ajouté" à ce secteur : l’économie parallèle qui permet aux trois opérateurs d’augmenter considérablement leurs chiffres d’affaires et aux commerçants de "Noghta Sakhina" (point chaud) de compter encore, pour des années encore, sur l’engouement des mauritaniens pour les téléphones mobiles et tous les gadgets qui les accompagnent.
Au moment où l’on parle de plus en plus d’une probable vente de Mattel et de Mauritel, ou encore de la reprise en main du secteur par l’Etat, au bout de deux ans, le secteur des télécommunications continuent à être le plus dynamique de tous ceux dont les retombées directes sur les Mauritaniens se font ressentir.
Paradoxalement, c’est aussi celui qui occasionne le plus de dépenses (achat de nouveaux téléphones, crédit, réparations, communications, internet, etc). Pas besoin de donner des chiffres pour le profane qui voit le dynamisme du secteur à travers l’activité qui règne au marché du portable et qui commence même à ’inonder" les autres parties de la capitale Nouakchott, avec l’émergence, tout le long des goudrons de boutiques de ventes de téléphones et de crédit, favorisée aussi par les promotions non stop des trois opérateurs.
Le boom du secteur a eu pour effet d’attirer l’attention d’une race de jeunes très portés sur les affaires depuis la libéralisation de l’économie. Ces golden boys qui rappellent les succès de l’Amérique des années 70-80, ont très vite compris le profit énorme qu’ils peuvent tirer du commerce du portable en exploitant à fond le goût des Mauritaniens pour les nouveautés.
C’est sur cette particularité mauritanienne que la nouvelle économie a joué pour faire ses nouveaux riches. Mais surtout occuper une jeunesse qui n’est aujourd’hui citée que quand il y a crimes, vols ou viols quelque part, oubliant que la responsabilité est partagée par le gouvernement, qui n’arrive pas encore à penser une bonne politique de la jeunesse, et les parents qui croient qu’après l’échec scolaire le suivi de leurs enfants s’arrêtent.
Un marché du portable, pour le meilleur et pour le pire
Disposer d’un portable est aujourd’hui à la portée de tout le monde. On n’est plus au tout début du phénomène portable où la Mattel et la Mauritel profitaient de l’absence d’un marché local pour vendre à des prix fixés en toutes libertés. On se plaint même aujourd’hui du fait qu’une personne puisse avoir plus d’un numéro, ce qui la rend "insaisissable", fermant le plus usité, pour disparaître subitement, et ouvrir un "secret" qui n’est donné qu’à certains privilégiés. Ainsi, avec le flair et le sens des affaires des commerçants mauritaniens, les desseins mercantiles des opérateurs de télécoms ont vite été contrecarrés. En peu de temps, ils voient leur échapper, impuissants, leur activité "portable" au grand bonheur des consommateurs.
Aujourd’hui, il suffit de se rendre à la "foire" du portable pour faire son choix à des prix qui défient souvent toute concurrence. Cependant le risque est grand de se faire avoir en payant un portable volé ou en mauvais état.
Car dans ce marché aux allures de caverne d’Ali Baba, où tout s’achète et se vend, il n’y a souvent ni foi ni loi.
Services et abus de confiance font bon ménage. Certains jeunes, sentant le profit qu’on peut tirer d’une telle activité, se sont improvisés "réparateurs" ou "vendeurs" de portables. Ils concurrencent sérieusement les magasins moins informels qui se sont installés tout le long de l’avenue J.F. Kennedy. Pour faire croire au sérieux de ce qu’ils font, les "réparateurs" vous passent en revue tout le jargon de la nouvelle profession : "déclencher une pile", "décodage", "habillage", etc.
Le ravitaillement des vendeurs de portables est assuré par des grossistes qui ont pignon sur rue au Marché de la Capitale et qui, faute d’avoir pu drainer la clientèle cible, sont venus vers elle. La filière Maroc, comme pour l’importation de voitures, est aussi très présente.
Certains commerçants mauritaniens n’ont pas hésité à dépenser des millions pour "acheter des clés" de quelques échoppes destinées à leur servir d’antennes dans ce lieu où se brossent chaque jour des montants énormes pour écouler leurs téléphones "made in Marocco".
Cette nouvelle forme de transaction, née de l’intrusion du grand capital dans l’économie du portable, a entraîné une inflation du prix du mètre carré sur ce terrain situé au centre ville et qui fait l’objet d’un litige depuis plusieurs années. L’opération la plus importante concerne la "vente des clefs" d’une place stratégique de 6m2 à 1,5 million d’ouguiyas, ce qui en fait probablement la terre la plus chère à Nouakchott. .
Ce phénomène inquiète les réparateurs et les petits vendeurs qui voient d’un mauvais œil la "dénaturalisation" de leur activité jusque-là essentiellement tournée vers la survie. Le loyer mensuel de 20 à 30.000 ouguiyas qu’ils payent aux responsables des lieux est appelé à augmenter chaque jour suivant le rythme d’activité du marché.
Les cartes prépayées, un pactole pour les revendeurs
La vente à la criée n’est plus la spécificité des journaux depuis l’arrivée du téléphone portable. Celle des cartes prépayées attire de plus en plus de monde, vu le profit qu’on peut en tirer en une journée de travail. Les vendeurs refusent obstinément de dévoiler la marge de bénéfice qu’ils gagnent sur une carte
Les grossistes n’ont pas cette méfiance et acceptent volontiers de donner le "cours" de la carte qui change d’un jour à l’autre. La Mauritel qui met sur le marché des cartes de 3000, 1500, 1000 et 500 UM les vend aux grossistes à 2600, 1200, 900 et 400 UM, ce qui leur laisse une marge de bénéfice souvent supérieure à 10% (cartes de 3000 et 1000). Le profit le plus grand est réalisé sur la carte de 1500 (25%) et celle de 1000 (20%).
Pour augmenter le bénéfice sur les cartes de 1000 et de 500, les plus recherchées par les consommateurs, les vendeurs feignent une rupture du marché et les proposent à 1100 et 600 UM, ce qui harmonisent malicieusement les bénéfices qu’ils réalisent sur cette activité qui rapporte gros.
Comme quoi il n’y a pas de sot métier et l’appât du gain est le défaut - ou la vertu - le mieux partagé par les Mauritaniens
Sneiba Mohamed