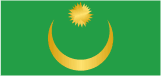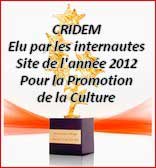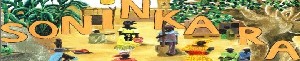04-10-2025 12:33 - "Maintenant, nous travaillons juste pour survivre" : le projet gazier de BP au Sénégal accusé d'appauvrir la communauté de pêcheurs

BBC AFRIQUE - Chaque jour, Gora Fall, un pêcheur local de la ville de Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, part en mer avec des sentiments mitigés : espoir et frustration.
Il espère faire une meilleure prise que la veille, mais il est frustré à l'idée que ce qu'il trouvera ne suffira peut-être pas à subvenir à ses besoins.
"Avant, nous travaillions pour vivre, mais maintenant, nous travaillons juste pour survivre", explique le jeune homme de 25 ans.
Comme lui, de nombreux autres petits pêcheurs traditionnels de Saint-Louis traversent une période difficile.
La ville est un important centre de pêche. Alors, qu'est-ce qui explique ce changement ?
La BBC s'est entretenue avec plusieurs pêcheurs et personnes liées au secteur de la pêche, qui désignent tous une seule et même cause : une plateforme de gaz naturel liquéfié située à la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie.
Le projet gazier Greater Tortue Ahmeyim (GTA) est exploité par le géant pétrolier et gazier multinational britannique BP dans le cadre d'une coentreprise avec Kosmos Energy, ainsi que PETROSEN et SMH, les compagnies pétrolières nationales du Sénégal et de la Mauritanie respectivement.
BP, qui détient une participation de 56 % dans le projet, a commencé ses activités au Sénégal en 2017 après la découverte de gaz naturel deux ans plus tôt.
Décrit comme l'un des projets de développement gazier les plus profonds et les plus complexes d'Afrique, la première phase de ce projet offshore de plusieurs milliards de dollars devrait produire environ 2,3 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an pendant plus de 20 ans.
Cependant, les habitants de Saint-Louis affirment que cela s'accompagne également de restrictions sur la pêche, dont dépendent 90 % des 250 000 habitants de la ville pour leur subsistance.
Zone d'exclusion
Un mardi matin, lorsque les conditions météorologiques sont déclarées favorables, Fall prépare son canoë en bois décoré de rayures rouges, bleues, jaunes et d'autres couleurs assorties.
Avec son hameçon et son appât, il part pour sa journée de pêche.
Après avoir parcouru 10 kilomètres au large, le jeune homme de 25 ans s'approche de l'immense installation gazière. Mais il explique qu'il ne peut pas s'en approcher davantage en raison d'une zone d'exclusion de 500 mètres qui restreint la pêche.
"Les autorités nous interdisent de pêcher dans cette zone autour de la plate-forme, sous peine de confiscation, voire de destruction de notre matériel de pêche si nous y accédons", explique Fall.
Les pêcheurs affirment que la plate-forme est construite autour d'un récif naturel riche en poissons. Ils affirment que ces restrictions réduisent leurs prises et qu'ils peuvent à peine gagner leur vie.
"Nous sommes très frustrés", déclare Fall.
"Maintenant, nous pouvons rester jusqu'à 16 heures à nous tourner les pouces, sans poisson."
Mais BP affirme que les préoccupations concernant les stocks de poissons sénégalais sont antérieures au projet gazier, déclarant à la BBC dans un communiqué : "les zones de sécurité autour des infrastructures sont une pratique courante pour protéger les personnes et les biens."
Lors d'un forum organisé à Saint-Louis en octobre 2024, le ministre sénégalais de l'Énergie, du Pétrole et des Mines a exprimé la nécessité de faire coexister l'exploitation pétrolière et gazière avec la pêche, qu'il a qualifiée d'essentielle pour la communauté locale.
Industrie de la sous-traitance
Un bac en plastique rouge et gris débordant de poissons fraîchement pêchés.
Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la pêche représente près de 60 000 emplois directs et plus d'un demi-million d'emplois indirects au Sénégal. Elle emploierait également une personne sur six et représenterait environ 3 % du PIB du pays.
La majorité des personnes travaillant dans ce secteur sont des pêcheurs et des transformateurs à petite échelle, traditionnels ou « artisanaux ».
La transformation est traditionnellement effectuée principalement par des femmes. Mais avec la pénurie de poissons constatée à Saint-Louis, beaucoup perdent leur emploi.
Diamol Sène, qui sèche du poisson salé au soleil, explique que certaines des femmes qui travaillaient auparavant avec elle dans un site de transformation du poisson sont aujourd'hui au chômage.
"Le poisson est devenu trop cher ; les coûts de transport sont élevés. Aujourd'hui, nous gagnons juste assez pour couvrir nos dépenses", explique cette mère de dix enfants.
"Si les pirogues pouvaient prendre la mer et revenir avec des prises [abondantes], toutes les femmes retourneraient travailler sur le site", ajoute-t-elle.
Les pêcheurs affirment qu'ils gagnaient auparavant entre 250 000 FCFA (environ 443 dollars) et 350 000 FCFA (620 dollars) par sortie de pêche, mais qu'aujourd'hui, ils ont du mal à atteindre les 50 000 FCFA (environ 88 dollars).
La baisse des profits pousse de nombreux pêcheurs, dont Fall, à envisager d'abandonner leur activité séculaire, considérée davantage comme un héritage que comme un métier.
"Nous sommes obligés de continuer à pêcher, car nous n'avons pas d'autre choix", explique-t-il.
"Mais si une opportunité d'emploi se présente, nous la saisirons sans hésiter."
D'autres ont déjà abandonné la pêche pour se tourner vers d'autres opportunités, notamment en émigrant vers l'Europe en quête d'une vie meilleure.
Saer Diop, 38 ans, fait partie de ceux qui ont abandonné la pêche. Depuis 2021, ce pêcheur de longue date travaille également comme charpentier, fabriquant, réparant et peignant des pirogues.
Il a acquis ce savoir-faire lorsqu'il était beaucoup plus jeune et le considère aujourd'hui comme une bouée de sauvetage face à l'adversité.
"Actuellement, je gagne mieux ma vie avec la menuiserie qu'avec la pêche", explique-t-il.
S'il admet que le travail de menuisier n'est pas régulier, il affirme que la pêche est devenue "très difficile" en raison du projet gazier.
Mais BP insiste sur le fait qu'elle "s'engage à opérer de manière responsable" aux côtés de ses partenaires et des communautés locales.
Tout en célébrant le lancement des exportations de gaz depuis l'installation en avril 2025, le ministère sénégalais de l'Énergie, du Pétrole et des Mines a appelé en avril 2025 à "une vigilance constante afin de garantir l'efficacité, la transparence et la durabilité des avantages économiques pour la population".
Il a également salué le projet gazier comme un projet qui renforce la position du pays sur la scène énergétique mondiale.
Le "débat" sur les récifs coralliens
Les membres d'une association locale représentant les pêcheurs artisanaux de Saint-Louis affirment que BP n'a pas tenu sa promesse de créer des récifs artificiels où ils pourraient pêcher davantage.
Ces récifs devaient servir d'alternative, étant donné que l'accès au récif naturel, connu localement sous le nom de "Diattara", est restreint.
"Lorsqu'ils sont venus en 2019, ils ont dit aux gens : "nous allons vous construire huit récifs artificiels" pour au moins remplacer notre Diattara", explique Nalla Diop, porte-parole de l'association des pêcheurs.
Cependant, il affirme que six ans plus tard, "rien n'a été fait".
La BBC a obtenu des documents issus d'une étude menée par le Centre de recherche océanographique de Dakar-Thiaroye (CRODT) au Sénégal, qui montrent que 12 sites potentiels ont été initialement explorés pour accueillir les récifs artificiels. Parmi ceux-ci, six ont été présélectionnés pour accueillir des récifs artificiels.
Cependant, le Dr Modou Thiaw, chercheur principal au CRODT qui a dirigé l'étude, affirme que seuls deux de ces sites ont finalement été retenus et proposés à BP.
Il décrit le processus de mise en place d'un récif artificiel comme "extrêmement lent".
Dans un communiqué, BP indique qu'entre 2021 et 2023, des études de faisabilité et des évaluations complémentaires ont révélé que seuls deux des douze sites récifaux "ont été jugés propices à la mise en place d'un récif de taille importante sans risque d'immersion ou d'érosion".
"L'un de ces sites se trouvait dans la zone marine protégée (ZMP) de Saint-Louis et n'a donc pas été retenu, car il n'aurait pas apporté de bénéfices immédiats aux pêcheurs de Saint-Louis", ajoute le communiqué.
BP indique que le site retenu accueillera un important complexe récifal qui comprendra 10 groupes de récifs.
"Les travaux sont déjà en cours et le récif devrait être achevé d'ici la fin 2025", indique BP.
La société affirme qu'une étude d'impact environnemental et social approuvée en 2018 a conclu que la perte de zones de pêche potentielles en Mauritanie et au Sénégal résultant du projet gazier serait "négligeable".
Au milieu des débats sur la faisabilité des récifs artificiels, un autre point de discorde concerne leur emplacement.
Les pêcheurs affirment que BP prévoit de construire le récif artificiel à seulement quatre kilomètres de la côte, estimant que cet emplacement n'est pas propice à l'attraction des poissons.
Cependant, BP affirme qu'une évaluation technique a conclu qu'un "groupe" de "pyramides récifales" à cet endroit permettrait une gestion et une protection plus efficaces de ce récif.
Préoccupations environnementales
Le gouvernement sénégalais a déclaré qu'il y avait eu une fuite de gaz en février 2025 – qualifiée de "bulles de gaz" par BP – dans l'un des puits exploités par le géant pétrolier et gazier.
Cet incident a suscité des inquiétudes quant à la sécurité de la vie marine autour de l'installation.
Mamadou Ba, militant océanique basé à Dakar pour Greenpeace Afrique, affirme que les fuites de gaz pourraient avoir des "effets incommensurables" sur l'environnement.
"BP refuse de divulguer la quantité réelle de gaz qui s'est échappée", ajoute-t-il.
Il précise que les experts ont constaté qu'une telle fuite de gaz pouvait détruire la faune et la flore marines, les récifs, les algues et les ressources qui permettent aux poissons de se nourrir.
Cependant, BP a déclaré à la BBC que l'impact environnemental avait été jugé "négligeable".
"Nous avons agi rapidement, bouché le puits et collaboré en toute transparence avec les autorités réglementaires", affirme la multinationale.
Dans une déclaration commune publiée le 14 mars, les ministères sénégalais de l'Environnement et de l'Énergie ont déclaré que les tests et observations effectués avaient révélé qu'il n'y avait plus de fuites après la réparation du puits par BP.
"Les images satellites prises après l'intervention n'ont révélé aucune présence de bulles ou de condensats à la surface de l'eau", indique le communiqué, qui exprime également l'engagement des autorités sénégalaises et mauritaniennes à améliorer en permanence la gestion des activités du projet gazier "afin de minimiser la survenue de tels incidents à l'avenir".
Mais la fuite a renforcé les inquiétudes locales concernant l'impact du site gazier.
Les représentants des pêcheurs artisanaux de Saint-Louis affirment que la promesse de prospérité économique liée au projet a un coût élevé.
Ils affirment que cela les prive du libre accès à leur mer tant appréciée, les laissant dans un avenir incertain.
Ils accusent également le gouvernement de prendre le parti de BP à leur détriment.
"Nous n'avons que la mer pour vivre", déclare M. Fall.
Le gouvernement sénégalais n'a pas répondu à la demande de commentaires de la BBC.
Reportage supplémentaire réalisé par Michel Mvondo de la BBC à Saint-Louis.