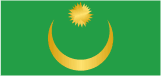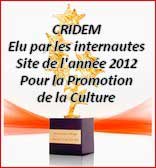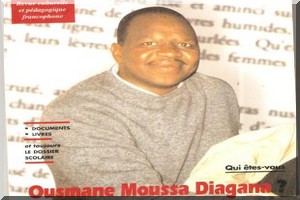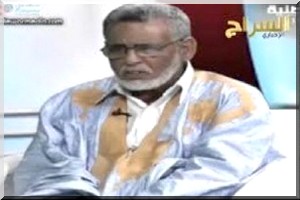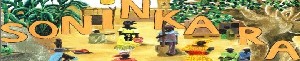Authentification
Pour S'authentifier veuillez fournir votre Pseudo et Mot de passer et cliquez sur : Se connecter
L'info en continu
< Precedent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Suivant > Environ 768 resultats
Copyright CRIDEM (Carrefour de la République Islamique DE Mauritanie)
Enseigne de Cridem Communication - Sarl - Tous droits réservés